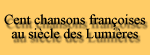
42
BOIRE, LA FARIDONDAINE, LA FARIDONDON
BOIRE, LA FARIDONDAINE, LA FARIDONDON
1
L'aimable boisson
Que le jus de la treille
C'est avec raison
Qu'on en dit merveille, bon
La faridondaine gai
La faridondon.
2
De cette liqueur
Vantons l'excellence
Faisons tous honneur
A sa bienfaisance, bon
La faridondaine gai
La faridondon.
3
De ce jus divin
Remplissons nos tasses
Et dans ce festin
Buvons avec grâce, bon
La faridondaine gai
La faridondon.
4
Le doux passe temps
Que celui de boire
En rogne bon temps
Imitons Grégoire, bon
La faridondaine gai
La faridondon.
5
Le jour et la nuit
Il aimait à boire
Du moindre réduit
Il faisait sa foire, bon
La faridondaine gai
La faridondon.
6
Un vaste tonneau
Rempli de quoi boire
Sera le tombeau
Qu'on doit à sa gloire, bon
La faridondaine gai
La faridondon.
De la treille à la tasse de Grégoire
Sous le titre Le batelier de Saint Cloud, narrant les déboires amoureux dudit personnage dans un style poissard, l'air de la présente chanson est donné dans le Chansonnier français(1) de 1760-1762 . On le retrouve aussi dans la Clé du Caveau(2) , en diverses cotations et variantes. L'intitulé La faridondaine gai, la faridondé, ou Vive un bon luron(3) explicite le sujet traité.
Cette formule finale de chaque strophe est un casse tête pour encyclopédistes attitrés, Littré refusant même d'y voir une source étymologique. Certains proposent une onomatopée basée sur dondon, ou mot dérivé de dondaine (une cornemuse médiévale), voire un terme composé à partir d'un radical far- (d'agitation corporelle) et de redonder. Reste que de cette formule, à la fin des strophes d'un vaudeville souvent réutilisé, est dérivé aujourd'hui quasi l'équation : faridondaine = "refrain de chanson", de nature en général bachique, festive ou gaillarde.
Le fait que la version du Chansonnier français, avec une note de plus dans la séquence musicale portant la rengaine habituelle, entraîne corrélativement une syllabe de plus dans un mot étant alors la fariradondaine complique encore le problème. Nous ne savons pas s'il s'agit là seulement de suivre la ligne mélodique avec une syllabe supplémentaire -ra-, chantée sur un la, donc bien accordée à la tonalité ou/et d'une forme originaire dudit mot, raccourci aux décennies et siècles suivants, ce qui relancerait le débat étymologique.
Par contre gué, mais simplement écrit gai dans le manuscrit Berssous, est une exclamation de gaieté qui se passe d'explication.
Un seul mot de la première strophe, nous situe bien il y a deux siècles. Le jus de la treille, certes suggéré pour une bonne rime avec le 3ème vers, évoque le support où grimpe la vigne. On a en tête l'image rurale de Sainte Beuve vantant "un sorbet mousseux et frais qu'on prendrait en été sous la treille", car plus on avance vers le nord, et sous un climat continental, plus la nécessité est pressante de cultiver la vigne en espalier, pour obtenir une maturité parfaite du raisin. C'est ce mode de conduite de la pousse le long des murs qui prend plus particulièrement le nom de treille, mais l'on nomme à la fois treilles, et les berceaux de verdure en vigne sur treillage qui jadis décoraient aussi bien les jardins de ville que ceux des résidences campagnardes, et les vignes de grande culture fixées sur palissades.
Le nom de treille a été donné dès le XVIème siècle à ce type de technique viticole, quand apparaît ce qu'on appelle le "petit âge glaciaire", qui durera jusqu'à la mi XIXème siècle, avec un climat européen plus froid qu'aujourd'hui, d'où des langues glaciaires qui descendaient alors davantage dans les vallées alpines. On fit donc grimper l'utile plante en espalier, sur treilles, sur vieux troncs de châtaigniers (dit "crosses" en Chablais) afin qu'elle prenne plus haut l'ensoleillement et échappe aux gelées à ras du sol.
La tasse pour boire le vin n'est pas moins récipient historiquement typé. Pour goûter le bachique breuvage elle a légué sa forme, voire son métal, mais pas son étymologie, au taste-vin. Elle reste populairement comme mot désignant le verre de vin, car jusqu'à la Révolution le breuvage, dans les cabarets, fut servi dans des tasses en faïence grossière.
La présence de Grégoire, dans les trois dernières strophes, se rapporte à un noceur fauché, amoureux de bonne chère, vin abondant, demoiselles, et devenu un stéréotype dans la chanson du 18ème siècle, comme en témoignent les exemples donnés par le Chansonnier françois(4) ou plus récemment par G. Delarue(5). Grégoire apparaît aussi dès 1640 dans les recueils de noëls.
Chansonnier françois II, n°6 :
Semblable louange de la consommation conviviale du vin se développe dans la chanson qui suit, du même genre poétique et musical bien établi, et non exclusif d'un public de cabaret. "Ainsi dans le salon si intellectuel de Mme de Lambert on entendait les pétillantes chansons à boire composées par Mme de Saintonge"(6), tandis qu'un père capucin, le père Abraham, à Santa Clara, publiait un recueil apprécié, intitulé : La cave bien garnie dans laquelle beaucoup d'âmes dévotes peuvent se désaltérer avec des chants pieux. Et les deux tomes d'Arthur Dinaux, Les sociétés badines, bachiques, littéraires et chantantes, ont répertorié grand nombre d'associations qui contribuèrent, au XVIIIème siècle, à maintenir l'engouement pour la chanson bachique : Ordre de la boisson, Ordre du bouchon, Société des amis de la goguette, Confrérie des buveurs, Ordre de Noé, etc. La plus célèbre des sociétés, le Caveau, publia Les chansons joyeuses et de table, dues, notamment à Piron, le bourguignon salé, Panard surnommé le "La Fontaine du Vaudeville" puis "Le Dieu du Vaudeville", les deux Crébillon père et fils, Moncrif, l'abbé de Lattaignant, etc. L'occasion pour la librairie Ballard d'éditer Tendresses bachiques ou duos et trios mêlés de petits airs tendres et à boire des meilleurs auteurs.
(1) Op. cité, t. II du reprint Slatkine de
1971, p. 453 et p. 509 (air n°6).
(2) Op. cité, n°681 de la table.
(3) Ibid., n°306.
(4) Op. cité IX, 116 - IV, 20 - I, 68.
(5) Voir "La foi de la loi", MAR 1984, CNRS, CNL et MD éditeurs,
p. 197 et suivantes. L'étude renvoie notamment à L.-P. Gras et ses collectes
de chansons foréziennes vers 1865.
(6) La chanson avant la Révolution, p. 301, in

