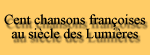
GLOSSAIRE ET INDEX(1)
(Les chiffres en gras renvoient aux chansons)
(Les chiffres en gras renvoient aux chansons)
Accent : C'est l'élévation et l'insistance de la voix sur l'une des syllabes d'un mot. Le français est une langue oxytonale, c'est-à-dire que l'accentuation se fait sur la dernière syllabe non caduque du mot ou du groupe de mot. En poésie française deux accents fixes tombent l'un sur la rime, l'autre sur la césure.
Agnosticisme : Voir Athéisme. 94
Alexandrin : Dodécasyllabe divisé en deux groupes de six syllabes dans sa forme canonique. 32, 33, 66
Air de cour : Comme pour le "vau-de-ville" c'est une mélodie simple, monodique, se répétant à chaque strophe et pouvant se chanter sans accompagnement, mais s'en distinguant par le raffinement, grandissant après 1625-1630, pour charmer plutôt l'oreille que développer le sens de la réflexion. 44

Ambitus : Ecart, étendue d'une mélodie du son le plus grave au plus aigu. III, 10, 14, 18, 49
Amuissement : Disparition en certains cas de la prononciation d'un phonème, comme le h aspiré, le e¸ le s (ce dernier s'étant amuï dès le XIIème siècle, mais s'étant écrit jusqu'au XVIIIème siècle).
Anacréontique : Genre où l'on recherche à imiter l'insouciante gaieté des poésies d'Anacréon (environ 560 à 475 avant J.-C.) ; voir III, chansons 28 et 33.
Ariette : (ital. dimin. de aria, air) Petit air détaché, de style aimable et tendre. 6, 31
Athéisme : Doctrine ou attitude niant l'existence de Dieu, donc plus radicale que l'agnosticisme d'après lequel tout ce qui est au delà du donné expérimental (tout ce qui est métaphysique) est inconnaissable.
Atone : Voyelle atone, syllabe atone : qui n'ont pas d'accent tonique (v. accent).
Ballade : Forme de poème d'héritage médiéval. Elle comporte en général trois strophes isométriques suivies d'un envoi sur les mêmes rimes.
Barcarolle : Chanson des gondoliers vénitiens. Par extension pièce de musique vocale ou instrumentale sur un rythme berceur à trois temps. II
Bergerie : Poème, récit, pièce de théâtre mettant en scène les amours de bergers. II, III, 7, 51, 63, 89
Bouquet à Chloris, à Iris, etc… : Courte pièce de vers galants qu'on offre à la femme aimée. 29, 56
Branle : Ancienne dans en chaîne ouverte ou fermée. Moteur de la danse récréative, collective.
Brunette : Jadis, petite chanson tendre et facile à chanter. 36, 44
Caduc : En phonétique se dit d'un phonème sujet à l'amuïssement, comme l'e muet du français.
Cantabile : Mot du XVIIIème siècle (1757) pour qualifier une phrase musicale ou un morceau de chant au mouvement lent, d'un grand caractère mélodique, souvent empreint de mélancolie et d'une expression pénétrante. Exemple chanson 52.
Cantatille : Genre, forme de musique de chambre très répandu au XVIIIème siècle : œuvre courte, écrite pour voix seule avec airs et récitatifs, ou en forme de rondeau.
Carole : Danse médiévale chantée. Voir n. 2, chanson 65.
Catalectique : Se dit d'un vers grec ou latin qui se termine par un pied auquel manque une syllabe. 32
Caveau : Société de chansonniers, fondée en 1729 et qui connut des migrations successives dans divers cafés parisiens, dont le cabaret Le Caveau en 1737. Les mélodies en usage ou/et composées de 1733 à 1826 ont été rassemblées dans La clef du Caveau.

Césure : Du latin caesura "coupure" elle correspond au point de partage, en principe fixe, entre les hémistiches (v. ce terme) d'un vers de plus de huit syllabes. Dans un alexandrin elle se trouve après la sixième syllabe.
Chaconne : Danse à trois temps, à l'origine animée, et devenue grave et lente dès Louis XIII. 65
Comédie-Italienne : Nom sous lequel on désignait les diverses troupes de comédiens venus d'Italie en France du XVIème au XVIIème siècle. En 1762 la Comédie-Italienne fusionna avec l'Opéra-Comique du Théâtre de la Foire. 6, 31, 32, 56
Conduite : Cérémonie d'accompagnement du partant : effectif militaire de sa garnison, compagnon du Tour de France ayant accompli son devoir. 20, 91
Coupe : La coupe intervient à la séparation des mesures, à la division du mot en syllabes, à la division de la phrase en éléments ou groupes rythmiques. La coupe est placée en principe après l'accent, donc, dans le cas le plus fréquent, entre deux mots.
Couplet : Terme qui s'est spécialisé pour désigner une strophe dans une chanson gaie, mais à distinguer du refrain. Il ne répond pas aux impératifs stricts de la strophe et peut être composé de deux vers.
Cythère : Ile grecque au sud du cap Malée (Péloponèse). Ile d'Aphrodite, elle passa dans la littérature et dans l'art comme le pays idyllique de l'amour et du plaisir. Voir chansons 57, 60, 61.
Décasyllabe : Vers de 10 syllabes qui a été réservé par le XVIIème et XVIIIème siècle au domaine de la poésie plaisante. En principe le décasyllabe est affecté d'une césure après la quatrième syllabe. 13, 69, 94
Diachronique : Relatif au caractère des phénomènes linguistiques observés du point de vue de leur évolution dans le temps. III
Diérèse : Fait de prononcer et compter prosodiquement en deux syllabes une succession de deux voyelles dont la première est i, u, et ou.
Diphtongue (et triphtongue) : La prononciation spécifique de ces voyelles qui changent de timbre en cours d'émission s'est perdue progressivement depuis le XVIème siècle. Ainsi [oi], prononcée [oï] en ancien français, s'est réduite à [wè] pour la langue soutenue et à [wa] pour la langue populaire, cette dernière s'imposant avec la Révolution. Et dès la fin du XIIIème siècle, la prononciation [è] est attestée pour les imparfaits et conditionnels. (Bibliographie : rechercher P. Delattre, Ch. Turot, G. Zink.).
Distique : Réunion de deux vers de nature différente ou formant un sens complet. 87
Dizain : Strophe de dix vers.
E : En ancien français, tout e est prononcé.
Mais c'est un e sourd tel que dans :
Au clair de la lune
Mon ami Pierrot.
où, en fin de vers, bien qu'il fut prononcé, il n'était plus comptabilisé
parmi les syllabes : surnuméraire il caractérisait les rimes féminines.
Dans la susdite chanson, malgré six syllabes chantées, c'est un vers de
cinq syllabes que l'on compte comme dans Mon ami Pierrot !
Dans la langue française d'aujourd'hui le e caduc reçoit un traitement légèrement différent selon la zone linguistique : le locuteur de la moitié nord de la France l'estompe plus volontiers que celui de la moitié sud (voir élision). De 1967 à 1993 il y a eu en français regain du e caduc prononcé.
Eglogue : Petit poème pastoral ou champêtre, dans la plus agréable simplicité selon Marmontel. Assez souvent dialoguée l'églogue chante presque toujours les sentiments de l'amour. III, 17
Elégie : Poésie sentimentale et mélancolique spécialement d'inspiration amoureuse.
Elision : Effacement d'un élément vocalique final devant un élément vocalique initial, soit dans le compte des syllabes, soit dans la langue écrite ou orale. Dans la tradition classique, en règle générale, un e compte pour une syllabe quand il est placé devant voyelle, hormis cas d'élision, ou à la rime (apocope).
Enneasyllabe : Vers de neuf syllabes.
Epicurisme : (et Hédonisme) Doctrines plus ou moins matérialistes basées en partie ou totalement sur le principe que la morale repose sur la recherche du plaisir, de la satisfaction et de l'évitement de la souffrance.
Filigrane : Voir encart et illustrations ci dessous.
Euphémisme : Expression atténuée d'une notion dont l'expression directe aurait quelque chose de déplaisant, de choquant.
Foire (Théâtres de la) : Différentes sortes de spectacles qui figurèrent pendant près de deux siècles dans les parisiennes foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent. En 1697 la foire de Saint-Germain comptait par exemple les trois troupes des frères Allard, de Maurice et de Bertrand. Peu à peu les théâtres forains se mirent à représenter des scènes dialoguées, à reprendre les types de la Comédie-Italienne, à jouer des comédies à ariettes, embryons d'opéras-comiques. En 1762, l'Opéra-Comique de la Foire se fondit avec la Comédie-Italienne. 1
Fossile directeur : Fossile qu'on retrouve toujours dans certaines assises géologiques et jamais dans d'autres, et qui permet de les reconnaître nettement, voire de les dater. Expression qui sert de métaphore dans d'autres domaines de la recherche. III
Fredon : Chanson, refrain chanté à mi-voix, par extension du sens originel donné pour désigner des ornements ad libitum (passages, diminutions, roulades) que le chanteur improvisait sur un air donné. 6
Franco-provençal : Ensemble des dialectes français de la Suisse romande, de la Savoie, et en partie du Dauphiné, du Lyonnais et de la Bresse. II, III, 1, 11, 48, 69, 87, 89
Gavotte : Ancienne danse à rythme binaire, air sur lequel on la dansait.
Gémination : Redoublement d'un phonème (souvent consonne) ou d'une syllabe plus rarement. II
Hampe : Trait vertical des lettres p, q, qui s'étend en dessous de la ligne d'écriture. III
Hapax : Mot dont on ne peut relever qu'un exemple et d'attestation isolée. III, 85
Haste : Partie supérieure et verticale de la lettre s'élevant au dessus de la panse. II
Hédonisme : Voir épicurisme.
Hémistiche : Du grec hêmi, "à demi" et stikhos, "rangée, ligne, ligne d'écriture, vers". La fin du premier hémistiche est marquée par la césure, la fin du second par celle du vers. Les vers de moins de huit syllabes n'ont pas de césure, et dans les octosyllabes elle n'est ni fixe ni obligatoire. Voir chanson 13, 34, 69
Humanistique : Se dit d'une écriture employée par les humanistes italiens à partir du XVème siècle. L'écriture humanistique a servi de base aux caractères d'imprimerie dits "ronde" ou "romaine". II
Huitain : Strophe de huit vers. 16, 18, 27, 29, 37, 41, 47, 49, 55, 58, 72, 76, 78, 90
Iambe : Pied de deux syllabes, la première brève, la seconde longue.
Incipit : Premiers mots d'un manuscrit, d'un livre, d'une chanson dont ils donnent souvent le titre dans les catalogues des œuvres répertoriées.
Jambage : Chacun des éléments verticaux des lettres m, n, u. II, 92
Isométrie : Fait d'utiliser un seul type de vers. L'inverse est l'hétérométrie.
Laisse : Les vers d'une même laisse étaient tous chantés sur un seul et même motif musical ou sur deux motifs alternant, à l'exception du dernier vers qui pouvait former un fragment libre avec une formule spéciale.
Lettrine : Lettre ornée ou non, placée au commencement d'un chapitre ou d'un paragraphe, et en général plus grosse que les autres caractères du texte. II
Libertin : 1/ Celui qui refuse de croire à la révélation surnaturelle et qui ne veut se diriger que par la raison, en suivant la nature. 2/ Celui qui mène une vie déréglée et débauchée. III, 19, 24, 45, 54, 69, 86
Lumières (Philosophie des) : Philosophie reposant sur la raison, sur l'expérience et sur les sciences.
Mesure : En poésie on appelle traditionnellement mesures les groupes de syllabes qui se trouvent entre deux accents.
Métaphore : Procédé d'expression qui consiste à désigner par une sorte de transfert, en employant à propos d'un mot ou d'une idée un mot qui convient pour un autre objet ou une autre idée, rapprochés des précédents par une analogie.
Mètre : Du grec métron, mesure.
Métrique : Système des mesures fixes qui définissent l'organisation interne d'un vers.
Mineure (Tonalité) : Dont l'accord fondamental (celui de la tonique) est mineur, l'intervalle mineur étant celui qui est plus petit d'un demi ton que l'intervalle majeur formé du même nombre de degrés.
Neuvain : Strophe de neuf vers. Rare. Les combinaisons de vers sont multiples. 69
Octave : Intervalle parfait de huit degrés de l'échelle diatonique. Intervalle de deux fréquences dont l'une est le double de l'autre. III, 14
Octosyllabe : Le plus ancien des vers français, de huit syllabes, a pour ancêtre le dimètre iambique latin. Le XVIIème siècle l'utilise dans les genres dits "mineurs", le XVIIIème le réserve également à de courts poèmes, à des épîtres. 65, 89, 94
Ode : Poème lyrique destiné à être chanté. 28, 32
Opéra-bouffe : Confondu avec le spectacle défini ci-après, l'opera-buffa napolitain était issu lui-même des intermezzi comiques insérés entre les actes de l'opera seria. Il utilisait alors les personnages de la commedia dell'arte. Entièrement chanté l'opéra-bouffe était de caractère comique, utilisant peu d'acteurs. En 1782 le Barbier de Séville de Paisiello marque le triomphe de l'opéra-bouffe. 6
Opéra-comique : Mot qui explicite bien la parodie d'un opéra, à l'origine. Vaudeville d'une sentimentalité pastorale et naïve, l'opéra-comique est aussi un drame lyrique, généralement sans récitatif, composé d'airs chantés avec accompagnement orchestral, alternant parfois avec des dialogues parlés. 1, 6, 14, 32, 48, 56
Orographie : Etude, description, agencement des reliefs des montagnes. 74, 91
Oxytonale : Langue qui comme le français utilise des mots qui ont l'accent tonique sur la dernière syllabe.
Paléographie : Art et science du déchiffrement des anciennes écritures, particulièrement celles des inscriptions, des manuscrits et des chartes.
Paléontologie : Science qui étudie l'homme, les animaux et les végétaux fossiles.
Pastorale : Œuvre littéraire ou poétique dont les personnages sont des bergers souvent dépeints d'une manière conventionnelle. Sur le plan musical le modèle accompli du genre pastoral, inauguré par J.-J. Rousseau, est l'œuvre de Blaise, Annette et Lubin, sur des paroles de Favart, et qui fut donnée à la Comédie-Italienne en 1762. II, III, 1, 13, 17, 32, 37, 51, 58, 63, 80, 89, 90

Phonème : Plus petite unité de langage parlé. Le français comporte 36 phonèmes : 16 voyelles et 20 consonnes.
Pied : Unité rythmique constituée par un groupement de syllabes d'une valeur déterminée (quantité, accentuation) et dont l'une est marquée par un temps fort. C'est l'élément de la prosodie gréco-latine où chaque vers était formé d'un nombre fixe de pieds avec une dominante. Ce système fortement cadencé ne connaissait pas la rime et n'était possible que dans une langue dont les bases phonologiques s'accompagnaient d'oppositions quantitatives.
Point d'orgue : Prolongation finale de la durée d'une note ou d'un silence, laissée à l'appréciation de l'interprète et marquée par un point sur sa partition. Par extension "apothéose".
Poissard : Qui reproduit, qui imite le langage, les mœurs du bas peuple. Le mot "poissard" signifiait voleur au XVIème siècle. La chanson poissarde fut mise à la mode par Vadé, son disciple Lécluse et le comte de Caylus (Facéties) pour réagir contre les fadeurs de Dorat et de Gentil-Bernard. Cette littérature du plus primaire réalisme envahit les salons pendant la seconde moitié du XVIIIème siècle. 10, 31, 42
Prosodie : Etude des caractéristiques phoniques, des unités non segmentales, durée, accent, ton. La prosodie gréco-latine était fondée sur la valeur des syllabes, basée sur les voyelles longues et sur les voyelles brèves ; la française l'est sur le nombre de syllabes.
Quatrain : Strophe de quatre vers, forme la plus fréquemment utilisée dans la poésie française ; le quatrain peut se présenter soit avec des rimes croisées soit avec des rimes embrassées.
Queue : Partie verticale et inférieure d'une lettre s'inscrivant au dessous des deux lignes où se tient la panse. Synonyme de hampe. II
Quintil : Strophe de cinq vers se comportant comme le quatrain avec une rime forcément redoublée. 31
Refrain : Suite de mots ou de phrases qui revient interne ou externe dans chaque couplet d'une chanson, d'un poème à forme fixe. Voir chanson 39, 49, 65.
Rentrement : Refrain tiré du début du premier vers d'un rondeau (voir ce mot). Exemple chanson 65.
Regeste : Catalogue d'actes d'une même chancellerie ou d'un même personnage, lorsque, dans la série chronologique des actes, sont intercalées des indications empruntées aux sources narratives.
Rime : Se trouve en fin de vers, ou très occasionnellement
à la césure, comme disposition de sons identiques à la finale de deux
unités rythmiques. Voir chanson 13.
Les rimes plates (ou suivies, jumelles) se correspondent
deux à deux en une suite ouverte aa, bb, cc, etc.
Les rimes croisées (ou entrelacées, alternées) ont une structure
de répétition et d'entrecroisement sur deux rimes du type a b a b.
Les rimes embrassées renversent la structure précédente avec un
axe de symétrie selon la formule a b b a.
En rimes brisées se présente la chanson n° 13.
Pour la rime masculine ou féminine, liée au départ à des
faits de prononciation, la notion de genre n'est déjà plus à l'époque
classique qu'un pur phénomène de graphie : sont considérées comme masculines
les terminaisons sans e, et comme féminines celles qui en comportent
un, suivi ou non de -s ou -nt hormi, dans les finales en
-ent prononcées "an".
Romance : 1719 : "poème espagnol", et ultérieurement, musique sur laquelle est chantée une pièce poétique simple, assez populaire, avec un sujet sentimental et attendrissant. La romance de Lindor (chanson n°6) en est le type.
Rondeau : A l'origine chanson de danse, de ronde. Dans la plupart des rondeaux, le refrain, tiré du début du premier vers (on l'appelle le rentrement) s'ajoute, isolé, à la fin des deux premières strophes (voir chanson 65).
Rondel : Forme du rondeau en 4-4-5 vers, avec reprise de deux vers entiers.
Sensualisme : Doctrine de Condillac, selon laquelle toutes les connaissances proviennent des sensations, c'est-à-dire des impressions reçues par l'intermédiaire des sens.
Septain : Strophe de sept vers. 17, 31, 65
Sizain : Strophe de six vers, construite sur trois rimes.
Stance : Le XVIème siècle a, en même temps que "strophe", introduit le terme de stance, emprunté à l'italien stanza, avec, à quelques nuances près, le même sens.
Strophe : Du grec "strophè" (action de tourner, tour), où elle désignait le tour d'autel accompli dans le théâtre antique, elle signifie aujourd'hui la structure formant un système clos, déterminé de rimes et composé d'un nombre fixe de vers, au moins quatre dans la poésie savante.
Syllabe : Facilitée par l'absence de ton et de longueur variable en français, c'est l'unité du vers à partir de laquelle se fonde le rythme.
Syncope : En musique, prolongation sur un temps fort d'un élément accentué d'un temps faible produisant un effet de rupture dans le rythme.
Synérèse : Voyelles unifiées en une seule émission aux origines du mot (résultant d'une diphtongaison), ou de voyelles dont le contact est issu de la vocalisation d'une consonne originelle (ex : nuit venant de noctem).
Tercet : Groupe de trois vers unis par le sens et certaines combinaisons de rimes.
Thyrse : Rameau rituel, composite et symbolique que portaient les bacchantes du culte dionysiaque. Voir chansons 29, 56, 69. A l'origine du prénom de Tircis.
Timbre : En musique motif mélodique tombé dans le domaine public, que reprennent certains auteurs de cantiques, parodies, vaudevilles, chansons, etc… pour accompagner des paroles de leurs compositions. Le timbre est synonyme de fredon, puis d'air au XVIIIème siècle.
Tonique : En versification se dit des syllabes accentuées par rapport aux syllabes atones. En musique nom donné au premier degré de la gamme diatonique. Note qui donne son nom à la tonalité sur laquelle repose cette gamme. Note de fréquence la plus basse de la gamme diatonique.
Triolet : Se compose de huit vers sur deux rimes avec des reprises de vers entiers. Voir chanson 65.
Vaudeville : A l'origine, chanson gaie, d'abord bachique, puis satirique et malicieuse. Sous cette forme le vaudeville dura jusqu'à la fin du XVIIIème siècle, époque à laquelle il se fondit dans le tout venant de la chanson française. C'est aussi une petite comédie légère, d'une intrigue amusante et vive, mêlée de couplets souvent composés sur un air connu et populaire.
Vernaculaire : Du pays, propre au pays, à ses indigènes. Langue vernaculaire, langue parlée seulement à l'intérieur d'une communauté, régionale par exemple.
Vers : En français il est syllabique et repose sur une connaissance exacte des règles et usages du compte syllabique. Pour plus amples précisions, notamment sur la diction, la préface de Tiersot (op. cité) détaille l'articulation de la versification dans la chanson.

Virelai : Forme de poème qui n'a pas vraiment dépassé le XVème siècle. La forme la plus générale, sur deux rimes, comprend trois strophes de même structure dont la première est introduite par un refrain de cinq vers, repris ensuite à la fin de toutes les autres.
Waux-hall ou Vauxhall : Célèbre jardin public d'un district londonien, sur la rive sud de la Tamise. Il fut ouvert en 1661 et attira la haute société.
(1) Bases : encyclopédies Larousse, Quillet, Robert, et La versification des P.U.F., plus le Dictionnaire de la musique chez Bordas.
FILIGRANE
Jusqu'à la fin du XVIIIème siècle, tout le papier fut fait à la main. Son filigrane, ou "marque d'eau" s'obtenait par l'empreinte d'un léger fil de laiton, soudé sur le treillis dense (du même matériau et alliage) recevant la pâte à papier, ou encore qui était cousu sur ce treillis avec du crin de cheval. Quelquefois le fil était entrelacé avec les vergeures, c'est-à-dire avec les susdits fils de laiton, ces supports parallèles et denses qui constituaient la sorte de toile métallique, plancher à la pâte.
Le fil engendrant le filigrane circulait librement selon les besoins du tracé décoratif de son motif. De plus, chacune des tringles de laiton, ou chacun des liteaux de bois qui soutenaient les vergeures de la forme laissait aussi sa propre et semblable empreinte transparente dans le papier, mais perpendiculairement aux génératrices dudit treillis. On la remarque facilement du fait de sa très nette lisibilité, compte tenu d'un espacement plus grand des gros éléments de cette charpente, aux noms significatifs : les pontuseaux, espacés de 2,2 à 2,5 cm dans les pages du manuscrit Berssous. Le nombre et l'écartement des pontuseaux ayant varié au cours des temps, leur disposition, ainsi que l'aspect des vergeures, permet de fixer l'âge d'un papier.
Le filigrane était un ornement certes, mais il permettait tout autant de repérer, utiliser, voire fiscaliser la feuille de papier porteuse de son empreinte. Son utilité apparaît dans la constitution d'un quelconque cahier du manuscrit Berssous : chacun des quatre feuillets qu'il regroupe se distingue, soit en haut de page, soit à l'angle supérieur (toujours contigu à la pliure), par divers motifs, servant donc de repères (y compris par l'absence de toute marque sur l'un desdits feuillets !) pour permettre un montage et enchaînement ordonné des pages écrites.

Les filigranes tracent les formes les plus libres, diverses, parfois même étranges, dont il n'a pas toujours été possible d'expliquer la signification. Vraisemblablement ces marques furent, dès l'origine, spécifiques à chaque fabrique et chaque moulin. Déjà très encadrées par la législation royale française dès le XVIème siècle, elles ont été même intégrées dans un véritable code de la papeterie en 1739. Les noms des formats (la couronne, la coquille, le raisin, le cornet etc…) tirent leurs noms des dessins filigraniques que les feuilles comportaient(1). Celui du cornet en était marqué d'un et, selon R. Gaudriault, il correspondait à un rectangle de 46 cm pour sa longueur et de 35 cm pour sa largeur . La similitude dimensionnelle avec les 4 feuillets d'un cahier du manuscrit Berssous apparaît, puisque ses 8 pages de 17,25 x 11,4 cm permettent de reconstituer un rectangle originel de 45,6 x 34,50 cm, donc très proche du théorique 46 x 35 pour 8 pages de 17,5 x 11,5 cm. Néanmoins les cotes des feuilles produites variaient par rapport aux dimensions normalisées selon les périodes et les fabricants. Mais surtout, au moment de la reliure, l'artisan rognait plus ou moins le volume sur ses tranches visibles, se devant d'être bien nettes et découpées. Il faut donc souvent s'attendre à des cotes de la pièce finie moindres que celles de départ. Toutes recoupes égales, celles concernant les deux petits mêmes côtés (haut et bas) du format rectangulaire du livre fini, l'amputaient donc du double d'emprise que sur le côté droit, sur toute la hauteur de l'ouvrage.
En résumé, si l'on tient compte de la pratique du rognage pour obtenir des tranches nettes on constate, chiffres à l'appui, qu'on aura enlevé 1 à 2mm sur chacune des trois tranches du volume, en le diminuant ainsi de peu par rapport à sa dimension initiale au montage. Et cette recoupe est d'autant plus certaine que la partie d'un filigrane, constitué par un libellé au sommet d'un feuillet de cahier est systématiquement amputée des caractères typographiques qui le constituent, selon une morsure qui rend son texte illisible.
Quels sont les filigranes discernables de notre manuscrit ? A la pliure d'un feuillet on en trouve deux types, par moitiés symétriques par rapport à l'axe que constitue cette charnière. L'un est une couronne portée ou soutenue à ses deux extrémités par un S ou une double spirale. Le second sujet, plus abstrait, lobé, en écu, sur un autre feuillet, semble complémentaire du précédent motif. On y reconnaît, associé à la couronne, le cornet sur écu polonais couronné avec pendentif. Un troisième filigrane, en haut de page d'un feuillet, constitue sans doute un libellé, mais le fait qu'il ait été amputé au niveau de la tranche du livre, ôte toute lisibilité à la compréhension des lettres le composant.
Au dessus de ce dernier élément sont aussi reproduits ci-joints les clichés négatifs des deux demi-motifs filigraniques les plus discernables, et en schéma les trois motifs dans leur globalité approximative, avec leur implantation vraisemblable dans la feuille du format cornet ou grand cornet in 8°.
Les techniques, les sujets en empreinte, le format du papier utilisé illustrent assurément une production classique de l'Ancien Régime, dont d'autres exemples sont fournis en parallèle pour les décennies précédant la Révolution(3).

Ce n'est pas un hasard qu'un recueil de chansons, vraisemblablement appartenant ou destiné à un militaire, ait eu son papier orné du filigrane d'un cornet, instrument de musique qui précéda le clairon dans les régiments d'infanterie, ou qui orna intérieurement l'habit des "chasseurs", corps de troupe dont plusieurs chansons du manuscrit Berssous évoquent la vie ou les exploits.
(1) G. Détersannes, L'histoire de France
en filigranes, Musée de l'affiche et du trait éd., 1981.
(2) A Annonay, chez les Johannot en 1766. D'après R. Gondriault,
Filigranes et autres papiers fabriqués en France aux XVIIème et XVIIIème
siècle, CNRS éd., 1995. L'exemplaire n°409, daté de 1777, est le
plus proche du présent.
(3) Exemples tirés de Wasserzeichen horn, de Hehard Piccard,
W. Kohlhammer, Stuttgart, 1979, t. IX. Voir aussi Monumenta chartae
papyraceae sur les filigranes des XVII-XVIIIèmes siècles, par E.
Heawood, Hilversum, Hollande. Les numéros 2755 et 2756 datés de 1788
et 1789 sont aussi proches du présent exemple. Le huchet ou cornet fut
un motif fréquent des filigranes d'Italie, de France et d'Allemagne,
avec maintes variations de dimensions et de formes. Les premiers exemples
semblent dus aux battoirs italiens et la France méridionale les développa.
Représentatif d'un format, le cornet fut au XVIIème siècle accompagné
d'initiales ou de nom et utilisé comme contremarque isolée.
