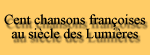
II
Le manuscrit, ses maîtres d'oeuvre et d'ouvrage
Le manuscrit, ses maîtres d'oeuvre et d'ouvrage
Le chansonnier trouvé en 1998 à la Chapelle d'Abondance est un manuscrit d'environ 250 pages, au format 11x17 cm, qui contient 94 chansons, en texte seulement, et sans partition, soit que le principal maître d'œuvre du recueil n'ait pas voulu délibérément laisser trace d'airs qu'il était seul à connaître et étaient clés de toute interprétation vocale, soit qu'il n'ait pas su lire ou transcrire la musique, voire même simplement parce qu'une telle notation, pour lui inutile, aurait été gourmande de papier et surtout de temps.
Charles Berssous, qui s'est notamment attribué la possession de l'ouvrage
en meublant maladroitement la partie supérieure d'un cartouche bien tracé,
composé avec goût sur la page d'en-tête, mais incluant la mention pleine d'assurance:
Se livre apartien a moÿ Charles Berssous, n'en n'est pas plus le seul
auteur que le second propriétaire qui s'y est déclaré, aussi laidement, juste
en dessous et d'une autre main: Ce livre apartien a moy ...........(1)
demeurant à la chapelle Canton de la Bondance, Despartement du lemant fait
a la Chapelle le 10 prerialle en 7ème de la République française, soit
le 27 mai 1799.
De ces deux premiers propriétaires successifs, qui n'ont pas su titrer avec art le cartouche qui attendait et méritait mieux, nous retiendrons l'unique nom disponible de Berssous, pour l'attribuer, par seule commodité identificatoire au dit recueil, livret ou/et manuscrit.
Juste mitoyenne, ou plutôt articulée sur la face interne du plat arrière devant armer la couverture finale, une pochette à soufflet (fermant par un lacet à l'attache noyée entre le carton de feuilles encollées qui constituent ledit plat) est tapissée par du papier peint. Signe du temps! Nous sommes peu avant ou pendant la Révolution, quand ce type de revêtement décoratif va se développer aux dépends de la tapisserie et de la tenture. Jean Papillon en 1688, à Paris, a inventé les dessins "à rapport" permettant de composer une tenture complète (avec ornements architecturaux, paysagers et botaniques). Et dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, Réveillon améliore la fabrication du papier peint: l'impression des couleurs utilise les procédés de l'indiennage.
Car le décor du présent échantillon consiste en bandes bleu vert sur le fond blanc avec leitmotiv d'un bouquet de deux fruits à queues feuillues, aux drupes rouges ou vertes, vraisemblablement celles de cerises. Motif qui n'est sans doute pas quelconque: c'est le temps des cerises, celui des gais rossignols et des merles moqueurs (J.-B. Clément dixit), c'est-à-dire celui de la belle saison avec les chants qu'elle engendre. Et cette pochette, un porte-feuille annexe en fin du recueil, suggère qu'elle aurait pu contenir de précieux brouillons de chansons prises sur le vif, en attente d'être recopiées au propre sur les pages vierges du dernier feuillet.
Mais la finition de l'ouvrage a été stoppée pour une cause qui nous échappe. Le dos du livre laisse bruts les dispositifs de couverture et brochage.
Resté en attente d'une reliure définitive (de qualité ou maroquinée) le recueil est constitué de cahiers cousus entre eux avec une fine ficelle (e=0,5mm) et les plats de couverture par un collage de vieilles feuilles usagées, couvertes d'opérations de calcul, d'exercices d'écriture et d'apprentissage de sa calligraphie. La page de garde finale provient d'une lettre d'amour ou d'un modèle de ce type de missive. On y lit:
"... Mais ce n'est pas assez, il faut qu'elles vous disent tout bas que je vous aime. Ce mot est trop hardi. Je ne veux ... plus le dire sans avoir une permission ... particulièr(e). C'est assez Mademoiselle que vous souffriez et que j'ai toute lestime possi.. pour vous et je me tiendrai fort heureux ... elle pourrait m'attirer l'honneur de vous... "
Le recto de la couverture arrière est occupé par des lignes répétitives d'une sentence tronquée: UN HOMME EST L'IN... avec entre les deux premières, la fine mention: Claude Pierre Bersous, autre individu, au moins par son nom, apparenté à un des propriétaires du manuscrit, Charles Berssous, d'autant que le prénom de Claude se lit discrètement dans l'angle supérieur gauche du croisillon accompagnant le cartouche de la page de garde(2).
Chaque page du recueil délimite la surface utilisable pour le texte par un encadré à double ligne, redécoupé par un trait constitué de deux lignes, faiblement écartées, l'une rouge et l'autre noire, chaque fois qu'il faut séparer deux chansons mitoyennes, dont celle qui précède est souvent terminée par fin et la suivante débutée par autre. La page de garde porte ce nom de Charles Berssous dont, tout en bout dudit patronyme, se superpose ou lie un motif graphique pâlichon, traité en arabesque d'enluminure, laquelle serait presque ex-libris dudit Berssous, encore qu'on la retrouve, identique, liée au mot fin de la dernière chanson, écrite d'une autre main.
Entre cette fin du recueil et la table des matières (en attente d'au moins 108 chansons (pré-numérotées) figure, parmi quelques pages vierges de tout texte, une courte recette pharmaceutique pour faire passer les points de côté en cas de pleurésie: un sirop à base d'huile d'olive, de racines d'orties et de bo... (?) cuits.
Mais cette insolite et tardive intrusion, qui n'est pas inhabituelle dans les plus simples et populaires livrets de l'époque, où le carnet de chansons peut aussi servir pour tenir les comptes et les recettes pratiques, n'est sûrement pas imputable au rédacteur principal du manuscrit, d'autant que parallèlement un carnet de recettes d'apothicaire, nous l'avons vu, a été trouvé dans la même maison abandonnée, à proximité du présent recueil, et carnet qui est, lui, d'une autre main, mais du même tardif propriétaire: Curtaz.
La construction soignée et au préalable du cadre graphique où seront ensuite portées les chansons traduit le souci d'une mise en œuvre d'ensemble pour arriver à la qualité de la présentation. Le temps de réalisation n'a guère duré, à voir la grande régularité de l'écriture dans la plus grande partie du manuscrit. L'enchaînement des chansons ne traduit nullement leur arrivée en fonction de leur création et apparition. La chanson nº6, tirée du Barbier de Séville, donc datant au plut tôt des années 1772-1775, a été ainsi transcrite avant la pièce nº69 qui traite de la prise de Milan en 1733, soit quarante ans plut tôt.
Et elle devance aussi dans la numération les chansons se rapportant aux grandes batailles ou victoires des guerres de Louis XV qui lui sont encore antérieures. C'est dire que le classement n'est pas chronologique, tributaire d'une suite d'événements, de modes, et de l'écoulement des décennies. Les trois plus récentes pièces, datables approximativement (3), le sont parce que tirées du Nouveau recueil de chansons choisies, paru à Genève de 1782 à 1785, mais elles ne se situent pas à la fin du manuscrit Berssous, sauf pour son point d'orgue avec la chanson de L'Atteignant sur Voltaire et remontant cependant aux années 1777-1778. Et elle n'est pas de la même main que celle ayant écrit les deux autres.
Par contre il y aurait, parfois, plutôt tendance au regroupement thématique des chansons, lorsque trois bachiques s'enchaînent (42, 43, 44), quand deux concernant Cythère se suivent (61, 62), tandis que six (66, 67, 68, 69, 70, 71) portent sur les acteurs de combats militaires, réels ou fictifs.
Aucune des chansons du livret chablaisien ne se retrouve dans les quelques six cents ici ou là publiées de 1786 à 1789 (4), ni dans celles qui furent crées et vécurent sous la Révolution puis le Directoire. La récolte de l'auteur du livret se termine donc avant ces événements majeurs.
D'ailleurs le papier du recueil porte, selon les feuillets, en filigrane, un cornet dans un écu polonais couronné, figure dont on connaît maints exemples avant la Révolution, et qui doit relever d'un choix délibéré: cet instrument de musique qui précéda le clairon dans les régiments d'infanterie devait au mieux symboliser l'engouement du destinataire dudit recueil.
La paléographie est d'une grande utilité pour mieux connaître et situer les maîtres d'œuvre ou d'ouvrage du manuscrit. La base du comparatisme porte sur les 84 premières chansons (soit environ 89% du total) qui sont visiblement de la même main.
Leur calligraphie en est très soignée et appliquée, avec des lettrines très travaillées à chaque début de strophe. S'y ajoutent des chiffres ornementés pour numéroter les couplets. Les vers transcrits sont assis sur de fines lignes pré-tracées.
Typique du 18ème siècle, l'écriture est cette bâtarde d'origine italienne, dont la variante se définit ici par son module, et la taille de la queue des lettres : la hampe, ce trait d'une lettre qui descend sous la ligne d'écriture, mesure deux fois le corps des caractères. A noter deux formes de " s " selon que le signe est initial ou ailleurs dans le mot (exemple : sois). Et même lorsque le " s " est géminé, comme dans pousse, se maintient une troisième et ancienne forme de la lettre, évoquant celle du " f " et telle qu'on la retrouve couramment dans les textes de l'époque ou dans tel recueil de chansons imprimées en 1760, à Genève.

Le graphisme, rythmé par les lettrines, les majuscules et les boucles des jambages, par les pleins des "f" ou "s" géminés, des "p", des "q" au niveau des hampes, et par les barres des "t" réglées sur l'alignement général de la ligne supérieure des lettres minuscules, aurait plus d'harmonie calligraphique encore s'il y avait davantage de parallélisme dans les hampes et les hastes, alors que les crosses bouclantes des "d", les grands "c" courbés minent cette unité au profit d'une fantaisie sympathique. La recherche de l'uniformité, ou la facilité scripturale, se traduit souvent par l'absence de courbures de raccordement des jambages de "m" et de "n", ce qui les fait confondre avec des "u" et nuit parfois à la lisibilité du texte. Les lettres capitales, comme au 17ème siècle, témoignent d'un réflexe de solennité qui s'accompagne, pour certaines, d'application et de multiplication. La lettre "j", qui a été longtemps désignée par nos imprimeurs sous le nom de "i" hollandais, parce que ce sont les typographes de la Hollande qui les premiers en ont fait un usage, apparaît systématique, car c'est bien à la fin du XVIIIème que la séparation définitive a eu lieu. La cédille n'est par contre pas utilisée.
Les trois types d'accent (aigu, grave, circonflexe), quoique rares, sont présents. Le "y" est souvent pointé d'un tréma, rappelant un procédé de l'humanistique ronde livresque des siècles antérieurs. Comme dans l'ancien français, il est fréquemment employé dans les diphtongues à "i" final, spécialement comme " i " terminal, pour des raisons de lisibilité et d'élégance vieillotte. Les chiffres arabes ne sont, dans leur forme, pas moins caractéristiques de la graphie du 18ème siècle.
Tout cela pour conclure qu'avec ses qualités et défauts cette calligraphie n'est pas sans attrait. Comparée à celle de grands écrivains de l'époque elle ne déparerait pas : ses "p" sont tracés comme ceux de Voltaire ou ses "s" avec le polymorphisme de ceux de Jean-Jacques Rousseau.
La spécificité, la régularité, l'assurance de l'écriture de ces 84 premières chansons, en en comparant ses caractéristiques avec la lourdeur, l'irrégularité et la médiocrité du graphisme, libellant l'appartenance du livret en page de garde, par Charles Berssous, montre au premier coup d'œil qu'elle n'est pas celle de ce propriétaire.
Des exemples ? Berssous lui ne gémine pas les deux s centraux de son patronyme, en distinguant le premier par l'ancienne forme de la lettre évoquant le f. Son y minuscule possède une queue qui tend à se boucler en long retour arrière à la gauche et sous les lettres précédentes déjà écrites, alors que chez le vrai rédacteur le même y n'a qu'une queue courte, convexe en s'arquant vers la droite. Les c, en initiales minuscules ou majuscules, de cette essentielle première partie du manuscrit ont une ampleur élégante qui les accroche, sans liaison, avec la lettre suivante du mot, en prolongeant à droite, sous la ligne d'assise et sous ladite lettre, voire sous deux, l'envolée du mouvement curviligne dudit caractère c. Mais dans le prénom de Charles Berssous le c est lié au reste du mot et ne descend pas en dessous de l'assise générale. Les h diffèrent également et aussi nécessairement, compte tenu de leur accrochage différent au c : longue boucle efflanquée chez Berssous, mais petite, plus aérienne et potelée dans le gros du manuscrit, avec d'un côté, le jambage qui suit détaché, aigu, sans arrondi supérieur marqué, pas plus que pour les m et les n, et de l'autre, pour les mêmes éléments de ces lettres, les plus sages et scolaires enchaînements bombés des jambages successifs, impliquant un scripteur moins véloce. Pour les r c'est par contre l'inverse : les larges des Berssous ont un profil plus anguleux que les courts, hautains et arrondis qui sont tracés dans la partie majeure du manuscrit. Et pour la majuscule dudit patronyme les deux panses du B ont la protubérance mamellaire de quelque gretchen serveuse à la fête de la bière, alors que le fin scripteur joue avec les enchaînements de courbes et contre-courbes qui donnent à la lettrine du vineux Bacchus un ventre mais pas deux.
Les huit chansons suivantes (85 à 92) ont été écrites et tabulées en partie par une autre main habile qui a œuvré avec la même application que le prédécesseur, tant pour l'écriture courante que pour le dessin des lettrines. Mais le naturel revient toujours au galop. Les B majuscules se gonflent de boucles tire-bouchonnées qui affectent aussi souvent les hastes s'incurvant des d aux extrémités de mots, ou qui s'envolent de celle du chiffre 5 numérotant les strophes. Les f, les v, les r, les z et h minuscules diffèrent nettement, en tracés et en tailles, de ceux de la précédente partie. Les j ont de vraies boucles alors que celles des g se limitent à un plus ample arc mordant dans l'interligne, d'effet élégant, que n'affirme pas autant le premier scripteur.
Effet qui se répète identiquement sur le premier s dans les géminations.
On pourrait comparer aussi chaque lettrine pour noter les différences. Chez le second rédacteur le E majuscule n'est qu'une double sinuosité enchaînant courbes et contre-courbes alors que le premier rédacteur maintient le bouclage central et intermédiaire. Les a du premier sont encore souvent une broderie sur la forme minuscule de la lettre avec panse et jambage alors que le second systématise le A capital en chapeau pointu.
Enfin et surtout le module de l'écriture se réduit, les lettres deviennent mieux enchaînées, selon une caractéristique de l'époque où les écritures sont pour la plupart petites et davantage liées. Cette différence est donc chronologiquement cohérente. Et ce n'est pas cette seconde main qui a rédigé l'attestation d'appartenance du manuscrit à Charles Berssous, pas plus que le deuxième libellé, aux c en initiale de mots débordant largement en dessous dans l'interligne, c'est à dire selon une graphie où l'on ne reconnaît aucun des deux scripteurs principaux du manuscrit - sans avoir même à s'appesantir sur les autres lettres, tout aussi différentes, notamment pour leurs boucles maigrichonnes.
La chanson 93 permet enfin de retrouver le graphisme lourd du Berssous
mentionné comme maître d'ouvrage dans le cartouche.  Le
char- de "charme" et celui de "Charles" sont quasi
identiques. Les y doublement pointés, les s géminés, les
m et n sagement tracés se retrouvent dans les deux libellés
de même que leur module d'écriture trop gros et espacé pour la taille
du carnet, et sans souci de la découpe versifiée du texte ou du respect
de la modestie du format. Mais le graphisme devient plus souple dans les
dernières strophes.
Le
char- de "charme" et celui de "Charles" sont quasi
identiques. Les y doublement pointés, les s géminés, les
m et n sagement tracés se retrouvent dans les deux libellés
de même que leur module d'écriture trop gros et espacé pour la taille
du carnet, et sans souci de la découpe versifiée du texte ou du respect
de la modestie du format. Mais le graphisme devient plus souple dans les
dernières strophes.
La chanson 94, la dernière, offre la particularité d'avoir été rédigée par deux mains nouvelles. Ses deux premières lignes s'apparentent au style de Berssous par leur maladresse mais ne semblent pas de lui au regard de c très différents, mordant fort dans l'interligne en dessous de l'assise des lettres. La suite du texte est d'une quatrième main, différente des précédentes, plus simple que les deux premières, et mieux régulée que celle de Berssous. Le mot fin se prolonge par un motif graphiqué comme un ex-libris, et tel qu'on le trouve en page de garde où il termine sans la chevaucher, la dernière lettre du patronyme Berssous, réécrit par cette même main voulant comme ré-approprier le manuscrit au prénommé Charles.
Enfin, après la table des chansons une dernière page présente des bribes de mots mal écrits et tronqués d'où se détache à la fin une nouvelle mention d'appartenance, plus ou moins biffée. On croit lire :
C H Grande ae
Grande ville C H curtaz Curtaz Claude
L'an 1825 ce livre est à Claude Curtaz de la panthiaz à la Chapelle Celui qui le trouverons le rendrons à C H Curtaz
dont le patronyme est effectivement un familial dudit village de la Panthiaz et de la maison où fut trouvé le manuscrit.
Résumons. Ce recueil a eu au moins trois possesseurs, dont Ch. Berssous et ultérieurement Claude H. Curtaz, qui y ont porté nominalement mention de leur propriété. Et il a été rédigé, pour les chansons, par cinq mains différentes : une principale pour 84 textes, une seconde pour 8, une troisième, celle de Ch. Berssous pour 1, tandis que deux se sont associées (inégalement) pour le dernière chant.
Il est donc, à ce stade, difficile de démêler ce qui revient à qui. On peut être bon chanteur (amateur ou professionnel) sans pour autant savoir très bien écrire et orthographier des paroles. Rien n'empêche une personne aisée d'avoir confié à un calligraphe talentueux le soin de lui constituer un chansonnier qui ferait le délice d'un amateur éclairé ou le modeste placement d'un gestionnaire diversifiant ses petites économies.
A la qualité de la calligraphie s'oppose le caractère plus primaire du français rédigé, émaillé de fautes d'orthographe et grammaticales, d'incohérences de transcription pour un même mot, de contresens parfois. Rien n'en rend mieux compte qu'une telle même chanson qu'a donné le Chansonnier François en 1760 (5), dans une langue d'une qualité bien supérieure.
Certes au 18ème siècle, et à la date où un Charles Berssous ou autre fit des études sans doute encore modestes (6) (on ignore quand, mais il est adulte sous la Révolution), le français est loin d'être entièrement codifié, en témoignent les graphies et controverses de grammairiens, d'encyclopédistes, d'écrivains célèbres (7) et aussi d'académiciens. On ne saurait faire grief audit collecteur d'avoir une pratique incertaine sur les géminations ou non de consonnes, d'écrire encore des participes pluriels en " ez " puisque l'on retrouve de telles graphies dans les dictionnaires anciens auxquels il a pu se référer.
Et si l'on n'a donc pas de raison d'être trop exigeant sur les règles d'une langue mal systématisée, enseignée et transcrite, il reste que les incohérences et contresens posent le problème de la compétence et de la mission de l'excellent calligraphe du texte. Jamais de rature, là où il y a une faute manifeste, ou quand, à qualifier Bacchus de dieu divin au lieu de dieu du vin , il apparaît que l'idiot pléonasme n'a pas choqué le rédacteur, on peut se demander quel intérêt il portait à ce qu'il écrivait, sauf pour le soin et la qualité apportés à la beauté formelle de l'écrit. Mais alors son maître d'ouvrage n'était-il pas plus compétent, rigoureux, attaché au sens correct, à une logique de syntaxe et d'orthographe ?
Les recherches sur les auteurs ou/et les propriétaires du recueil sont demeurées sans résultat, non seulement pour son principal rédacteur, mais aussi pour le plus modeste et malhabile Charles Berssous qui s'est déclaré en page de garde propriétaire du manuscrit. La consultation des archives communales de la Chapelle d'Abondance, ou départementales d'Annecy n'a pas permis de retrouver le patronyme de Berssous dans le tabellion de 1792, dans la liste des baptêmes, mariages, sépultures de 1774 à 1780, dans le registre des propriétaires de la mappe sarde de 1738 ou des imposés pour régler les dégâts de la grêle en 1720. La bibliothèque généalogique de Paris a été consultée en vain. L'obligeant conservateur des archives cantonales de Sion, dans le Valais tout proche, parmi les documents disponibles de la famille et du régiment de Courten, peu ou prou impliqué dans quelques unes des chansons concernant les guerres de Louis XV, et compte tenu d'un engouement du principal auteur du manuscrit pour la collecte de textes se rapportant au monde et aux chefs militaires ou à la mouvance des armées dans l'Europe des Lumières, n'a rien trouvé. On sait qu'un bataillon de mercenaires suisses du régiment de Courten, commandé par un chef âgé, a quitté Thonon en 1792 pour rejoindre en Val d'Aoste le territoire encore tenu par la Maison de Savoie (8), c'est-à-dire en passant par la vallée de la Dranse, donc à La Chapelle-d'Abondance, afin d'accéder, via le Pas de Morgins, à la vallée du Rhône et au Valais, puis au col du Grand Saint-Bernard donnant accès au versant italien des Alpes.
Finalement, c'est à un éminent archéologue valaisan, Pierre-Alain Bezat, qu'on doit d'avoir retrouvé la trace, à quelques lieues à vole d'oiseau de la Chapelle d'Abondance, d'un Charles Berssous, très évocateur de celui qui nous intéresse. Voir l'encart ci-dessous, à partir de pièces administratives incontournables.
|
Le document concernant le dénommé Charles Berssoux (Bersoux) que je possède se trouve cité dans l'inventaire des archives privées, aujourdhui malheureusement éparpillées, de feu Henri Hauswirth de Monthey: Doc. 1. Mandat de citation au tribunal de Monthey, destiné à un certain Charles Bersoux, demeurant à Illiez, pour le samedi 3 mars 1798. Ce mandat n'a pu être remis comme le confirme le dos du document; le destinataire étant "a patria absente (sic)". Doc. 2. Séance du tribunal en date du 3 mars 1798. Audition de deux témoins dans l'affaire concernant François Constantin de Navian, anciennement soldat au régiment de St-Gall (Louis de Reding) au service d'Espagne. Nous nous sommes permis de rapprocher ces deux documents pour une raison assez simple: En date du 3 mars 1798, on ne trouve qu'une seule procédure judiciaire; celle que nous vous remettons en annexe sous doc. 2. Lors de cette audition de témoins, Charles Bersoux ne sera pas entendu car, à cette date, il avait déjà quitté le pays. Depuis quand? On ne peut malheureusement pas y répondre. Si l'on se réfère toujours au même document, Charles Bersoux semble avoir servi durant un certain temps en Espagne dans le régiment de St-Gall. Est-t-il, par la suite, passé au régiment de Courten au service de France? Ce n'est nullement impossible. En 1798, la Suisse, le Valais sont en pleine mutation. Depuis janvier, la Révolution a pénétré, d'abord dans le pays de Vaud, puis en Valais. Berne résiste dans les Ormonts, la conjoncture est tendue. De part et d'autres on mobilise, dans peu de temps, ce sera la guerre avec les résultats que l'on connaît. Soldat de l'Ancien Régime (?), assistant à l'arrivée de la Révolution dans le Valais même, confronté à une situation qui risque de dégénérer, Charles Bersoux décide brusquement de quitter le pays. Il n'y reviendra plus, du moins à notre connaissance. On le comprend d'ailleurs! Car en cette année 1798, au mois de mai, les Hauts-Valaisans se soulèvent; ils feront de même l'année suivante. De plus, rapidement, le Valais croule sous les impositions, certains Valaisans, surtout ceux résidant près de la frontière, quittent le pays pour se réfugier en Savoie comme le signale le sous-préfet de Monthey Dufay. Personnellement, je ne suis donc pas surprise de rencontrer Bersoux à la Chapelle d'Abondance en 1799 ! Reste à savoir maintenant, s'il s'agit bien du même personnage! Pierre-Alain Bezat Documents : fichier procédures civiles et criminelles châtellenie de Monthey Type, côte: Procédure civile 1798/ Doc. tiré invent. H. Hauswirth Le 21 février 1798 Le cit. Nantermod, juge de paix Papier. mandat de convocation pour être auditionné comme témoin, le samedi 3 mars en matinée, envoyé au cit. Charles Bersoux demeurant à Illiez. Affaire non-nommée. Dos du document, mention: A patria absente et date du 22.2.1798, signé Adrien Guerrati assesseur. Type, côte: Procédure civile PAB 1798 janvier 10 -1798 juin 28 Le 3 mars 1798 Le cit. Nantermod juge de paix de Monthey A comparu le cit. Jean Martin Ciprian de la commune de Verrès Duché d'Aoste agissant en vertu d'une procure du 27.2. dernier, Jean Pierre Garçon notaire, au nom de son père Antoine Ciprian, demandant en vertu d'un mandat du 2.3. que les citoyens Jean Pierre Fragnière et Victor Pot natifs de cette commune duement cités déposent par leur serment sur ce qui leur sera interrogé. Jean Pierre Fragnière 1. témoin. Q.1: S'il connaît un nommé François Constantin de Nabian. R.: Qu'il a connu un nommmé François Constantin de Nabian, qu'il l'a vu en Espagne fusilier au régiment suisse de Louis de Reding et qu'il a servi ds la même compagnie que le déposant pendant 3 ans et 6 mois et que le dit Nabian pouvait être agé de 20 à 21 ans, c'était en 1765, taille 5 pieds et un pouce environ, visage maigre, gros yeux noirs à fleur de tête, cheveux et sourcils châtains. Le dit Nabian lui a déclaré plusieurs fois qu'il était originaire de Verres en Val d'Aoste quoique ds sa capitulation se fut dit du Bourg de St Pierre en Vallais, et qu'il s'était nommé vallaisan afin de pouvoir être reçu au Service des Suisses et le dit déposant a laissé ce de Nabian au dit régiment en garnison à la Sierra Morena et qu'il l'a vu ici à Monthey 4 ou 5 ans après passant et disant qu'il allait à Verrès chez lui. Q.2: S'il sait que le dit de Nabian soit mort. R.: Qu'oui, qu'il a entre les mains un extrait mortuaire reçu dans une lettre que Guillot de ce même lieu de Monthey officier au régiment suisse de Rutiman au service d'Espagne lui a envoyé, lequel extrait le dit déposant a produit sur le bureau du dit juge. Victor Pot 2. témoin. Q.1: cf. ci-dessus: R.: Que oui à Madrid la capitale du Royaume d'Espagne au service du qiuel il était du régiment de Tzart ci-devant Louis de reding faisant le service de 1. sergent, soit fourrier de là il a passé en qualité de caporal ds le régiment St Gal Thurn qui s'appelle actuellement St Gal Ruttiman, il était de la compagnie lieutenante colonelle, qu'ils y ont servi ensemble l'espace de 11 ans, ce régiment St Gal ayant changé de garnison et étant venu à Sarragosse, le dit Nabian est entré à l'hôpital royal et général où il est mort, laissant sa petite femme et un garçon nommé Ignace lequel est tambour au dit régiment. Q.2: S'il sait d'où était ce Nabian. R.: Qu'oui, que le dit de Nabian lui a dit plusieurs fois qu'il était de verrès en Val d'Aoste, quoiqu'il se fut dit Vallaisan dans sa capitulation pour pouvoir entrer ds les Suisses. Q.3: S'il peut donner le signalement du dit Nabian. R.: Qu'il avait la taille de 5 pieds et un pouce environ, visage maigre, menton pointu, gros yeux noirs, cheveux et sourcils châtains.. Q.4: Quel âge il avait. R.: Que quand il est mort, il était âgé de 45 ans environ, et qu'il est mort à Sarragosse capitale d'Aragon ds l'hôpital prémentionné. Les dits témoins ont déclaré de plus que le dit François Constantin était appelé en Espagne de Navian parce qu'on y prononce V pour B. |
Les Courten sont originaires de Sierre plus en amont que le susdit linéaire de Rhône longé. Leurs officiers et leurs effectifs de mercenaires valaisans ont servi nombreux dans les armées françaises et sardes. Ces excellents soldats furent à l'œuvre à Fontenoy, dont une chanson du recueil vante les qualités militaires qu'ils y montrèrent. En Valais les uniformes des soldats suisses à l'étranger, conservés avec beaucoup de soin sont d'ailleurs ressortis périodiquement pour les festivals et les fêtes des villes ou de villages, illustrant ainsi un comportement d'engouement de la population pour la chose militaire et que l'on retrouve dans le présent manuscrit, nous y reviendrons, avec le choix de certaines chansons.
 Après
Sierre, la vallée du Rhône en amont permet d'atteindre le haut Valais, seule
partie du canton où la langue allemande soit en honneur, c'est-à-dire la région
de Goms. Et l'on ne peut s'empêcher de songer au patronyme germanique de Berssous,
à partir du radical ber(s) = ours + -wald. Sans plus !
Après
Sierre, la vallée du Rhône en amont permet d'atteindre le haut Valais, seule
partie du canton où la langue allemande soit en honneur, c'est-à-dire la région
de Goms. Et l'on ne peut s'empêcher de songer au patronyme germanique de Berssous,
à partir du radical ber(s) = ours + -wald. Sans plus !
Le passage relativement discret par le Pas de Morgins a en outre toujours été commode pour les fuyards de toute nature. C'est par lui que Giono fait passer vers 1850 le déserteur empruntant la Vallée d'Abondance pour s'établir au village valaisan de Nendaz où il peignit de fameuses fresques. Et aux alentours de la Révolution des mercenaires peu ou prou francophiles, mais pas nécessairement républicains, ont pu volontairement faire retraite sécurisante, sinon déserter dans une terre francophone, toute proche de leur natale, d'ailleurs insurgée et conquise sous le Directoire, donc entraînée nécessairement à une hostilité à l'égard des ex-" collabos " de l'occupant.
Mais n'est sûrement pas révolutionnaire un certain "Jean-Claude Berthet, ci-devant soldat de Courten, habitant de Richebourg, hameau d'Abondance" (quasi mitoyen de la commune voisine, La Chapelle d'Abondance) et qui se présente sur la fin du mois d'août 1793, armé d'un sabre, devant les édiles locaux pour les en menacer s'ils n'obtempèrent pas à son injonction de s'allier au camp piémontais ! (9)
Toujours est-il que s'égrènent ainsi, sur le linéaire menant au Pas de Morgins, deux attestations - celle de ce soldat, à Richebourg, et celle, un peu plus en amont, à la Panthiaz, du manuscrit Berssous avec deux chansons qui traitent de victoires : Berg-op-zoom et Fontenoy où intervient, peu ou prou, un bataillon de Courten, sous le commandement indirect mais supérieur du Maréchal de Saxe, dont une autre chanson dudit recueil loue la direction militaire (10).
Le choix des poésies retenues dans le recueil, par et pour leurs thèmes, avec leur dire et leur non-dit, leurs faits de guerre ou de mode et de genre, permettent cependant de situer, grosso modo, le collecteur des chansons dans la société et dans le temps, avec même son particularisme d'individu.
Ses goûts s'inscrivent sans écart dans l'évolution intellectuelle et culturelle des règnes de Louis XV et Louis XVI. Mais l'auteur n'a retenu aucune chanson de caractère politique, critique ou contestataire, alors qu'il n'en manquait point, comme si sa fonction dans l'administration, l'armée, ou sa nationalité étrangère lui faisait nécessité de neutralité et de réserve, car il n'y a pas davantage de textes laudatifs ou de flagornerie à l'égard du pouvoir, sauf peut-être pour les chefs militaires.
On peut situer l'homme dans le temps et le dire adulte durant une période allant des années 1730 - compte tenu de la chanson sur la prise de Milan en 1733 ou de l'apparition du verbe reluquer dans le vocabulaire, mot qui n'apparaît que vers 1730 - et, à l'autre extrémité de la fourchette, les années 1785-1786, où dans les Etrennes lyriques et anacréontiques aucune chanson postérieure à cette limite ne semble avoir été collectée. Le point d'orgue du manuscrit est la chanson de l'abbé L'Atteignant sur Voltaire, sur cet octogénaire âgé de 82 ans en 1778, et dont l'âge, souligné pour la sagesse philosophique qu'il induit, est le thème des paroles. Et comme si, in fine, le dernier rédacteur du manuscrit l'avait aussi atteint !
Le manuscrit comporte environ 30% de pastorales, sans même y inclure toutes les chansons d'amour. Or, dans une étude sur la chanson et musique populaire à la fin de l'ancien régime à partir des Mémoires Secrets de Bachaumont, les auteurs en relèvent du même genre pour 31% entre 1762-1770, 16% entre 1771-1779 et 18% entre 1780-1787. C'est dire que la similitude du premier pourcentage situe l'essentiel de la collecte de notre manuscrit sous le règne de Louis XV. Ce que confirme un autre pourcentage caractéristique du recueil Berssous, à savoir ses 16% de chansons militaires qui portent essentiellement sur les guerres de Louis XV ou de son époque, à savoir :
1- Prise de Milan en 1733
2- Bataille de Molwitz en 1741
3- Guerre de Succession d'Autriche en 1744
4- Victoire de Fontenoy en 1745
5- Prise de Berg-op-zoom en 1747
6- Blitz des chasseurs de Fischer en 1758
7- Guerre de 7 ans en 1762
Deux chansons plus anciennes, datées du siècle de Louis XIV, ont gardé leur vogue, non seulement durant les règnes suivants, mais après la Révolution. Telle est la marche cérémonielle (n°91) quand l'on bat la générale pour les troupes partant en campagne, puis devenue chanson que l'on retrouve en plein XIXème siècle avec un texte vindicatif lorsqu'une société de compagnonnage, celle du Devoir, s'apprête à nouveau à affronter, presque manu militari, la rivale des Gavots à laquelle appartint Agricol Perdiguier.
Et puis se maintient sur deux siècles la chanson, toujours chantée par Sabaudia (11), Hélas que je suis à mon aise, où l'amante savoyarde craint que les Piémontaises séduisent son soldat - alors que le texte du manuscrit Berssous situe ces avatars durant la guerre des Flandres, au début du XVIIIème siècle, mais avec une Flamande qui s'inquiète de la rivalité des Françaises. On savait cette célèbre chanson remontant au siècle des Lumières et le présent recueil en donne autre confirmation, comme pièce supplémentaire à l'enchaînement des variantes régionales et historiques, bien mis en valeur par J. Urbain (12).
La chanson sur le déserteur (n°48) concerne un soldat de l'armée française, mais rien n'empêche qu'il n'ait été quelque mercenaire valaisan à son service, puisque cette chanson et même son genre ont été si populaires tant en Savoie qu'en Suisse romande, donc en Valais où l'on en a des exemples. Et c'est dans ce canton catholique suisse qu'on retrouve la poésie 79 sur une religieuse malgré elle, y critiquant non la religion mais la cruauté mentale d'une mère sectaire. La poésie n°94, étoffant longuement la sagesse voltairienne et libérale d'un vieillard qui se confie à dieu, n'a-t-elle pas été folklorisée seulement en Val d'Aoste, sur le chemin des pérégrinations de militaires régionaux - certes porteurs de l'état d'esprit du XVIIIème siècle - mais demeurant aussi indigènes par quelque aspect de mentalité spécifique ? Car il existe dans cette durable communauté de culture franco-provençale propre à la Savoie et à la Romandie, une similitude qui va s'amplifier à partir du XVIIème siècle : le monachisme féminin, comme dans le reste de l'Europe, tend à régresser en Valais, de même qu'il faiblit aussi en Savoie, ce qui, de part et d'autre du Haut-Rhône, marque une moindre considération pour ce type d'attitude religieuse dans la gent féminine, et cela peut-être sous la pression du protestantisme concurrent, sans couvents ni célibat astreignants. Une ou deux chansons de curés faisant entorse à la règle d'abstinence inscrivent en tout cas bien le recueil Berssous dans la problématique du siècle.
Certes, pour authentifier un peu le maître d'œuvre du chansonnier comme valaisan, on aurait aimé y trouver une chanson telle que le Ranz des vaches, connue dès le XVIème siècle mais chantée dans le dialecte de la Haute-Gruyère, et qui avait la réputation, chez les mercenaires suisses du roi de France, de leur déclencher la " maladie de la mélancolie ", d'atteindre le moral des troupes, autant parce que de très simples paroles sur la conduite des vaches à l'alpage rappelaient leur patrie helvétique aux expatriés que parce qu'il est encore coutume, au pays gruérien, de le chanter traditionnellement les larmes aux yeux (13). Une chanson aux paroles justes, sans effets ni envergure philosophique ou poétique, ni utilisation d'une terminologie abstraite ou d'allégories mythologiques puisées dans l'antiquité gréco-romaine, peut avoir, avec et par son patois, un pouvoir émotionnel dépourvu de vulgarité mais qui, par contre, dût faire défaut à bien des bergeries du manuscrit Berssous.
Malgré cette insuffisance de qualité émotionnelle, des textes précieux (quoique trop souvent mal libellés) durent être conçus en bon français et reçus par une oreille éduquée à lui être plus sensible qu'au dialecte franco-provençal.
Dans l'utilisation du français la Suisse romande, pour ses aires à dominante protestante surtout, devancera la Savoie et aussi toute province française à mesure que cette dernière était plus éloignée de Paris. Parce que la Réforme, religion menée par des citadins et bourgeois s'installe à Genève, ses sommités ou compositeurs immigrés, le francilien Calvin, le gapençais Farel, le parisien Marot, dès le début, pensent, écrivent et prêchent dans la langue de l'Ile de France royale qui devient en Romandie la langue littéraire, politique, administrative et commerciale, alors qu'à la fin du XVIIIème siècle la moitié de la population française est encore incapable de parler correctement la langue nationale. En Savoie le souverain utilise le piémontais ou le français comme langue diplomatique, mais la langue vernaculaire de la terre natale de sa Maison reste seulement pratiquée par les prêtres catholiques qui sont près du peuple, ceux du petit clergé rural parlant patois. D'où nombre de textes en franco-provençal, portés par la chanson populaire jusqu'au XXème siècle (14).
Il n'y en a pas dans le recueil Berssous mais cela n'est nullement rédhibitoire pour la nationalité valaisanne du maître d'œuvre du manuscrit, puisque son français paraît aussi pur que celui d'un quelconque savoyard et d'un Suisse urbain, au pire usant de régionalismes quand ils le parlaient. Car la langue, pratiquée par le collecteur des chansons, qu'il n'a pas composées, n'en avait pas nécessairement toute la préciosité ni la qualité de leurs paroles (15).
Le choix, l'éclectisme dudit collecteur le montrent comme exclusivement
adonné à la chanson française. Les quelques pièces que l'on retrouve dans les ouvrages classiques sur
la chanson en Savoie, figurant aussi dans les recueils similaires d'autres
provinces, ne prouvent pas un provincialisme et une culture de souche
locale. Tout Savoyard qui se respecte aurait utilisé un terme local (la
talène) pour désigner par exemple le frelon intrus (16) qui figure
au contraire en français dans la chanson où l'insecte intervient. Il n'y
a aucun régionalisme de mot rural ou de tournure franco-provençale dans
les textes produits. Pas un seul élément naturel n'apparaît, même en français,
comme alpestre. La chanson sur la prise de Milan loue plutôt l'appartenance
autrichienne de cette ville que sa convoitise par la maison de Savoie
ayant pourtant basculé son intérêt outre-Alpes sur l'Italie du Nord. Et
on en sait plus sur divers pays européens et leurs mercenaires que quoi
que ce soit sur la région savoyarde et son Chablais où habitait Charles
Berssous. Son chansonnier donne plutôt le sentiment d'avoir été bâti par
un itinérant, officier par exemple, que par un vrai autochtone du monde
rural ou même urbain de la Savoie profonde. Lequel connaît moins le "vert
gazon", "le lys", "le jasmin" que sa prairie fleurie
à faner, le cyclamen ou la gentiane des pâturages. Néanmoins la chanson
sur les soldats valaisans à la bataille de Fontenoy apparaît bien comme
appréciée par un voisin frontalier.
Les quelques pièces que l'on retrouve dans les ouvrages classiques sur
la chanson en Savoie, figurant aussi dans les recueils similaires d'autres
provinces, ne prouvent pas un provincialisme et une culture de souche
locale. Tout Savoyard qui se respecte aurait utilisé un terme local (la
talène) pour désigner par exemple le frelon intrus (16) qui figure
au contraire en français dans la chanson où l'insecte intervient. Il n'y
a aucun régionalisme de mot rural ou de tournure franco-provençale dans
les textes produits. Pas un seul élément naturel n'apparaît, même en français,
comme alpestre. La chanson sur la prise de Milan loue plutôt l'appartenance
autrichienne de cette ville que sa convoitise par la maison de Savoie
ayant pourtant basculé son intérêt outre-Alpes sur l'Italie du Nord. Et
on en sait plus sur divers pays européens et leurs mercenaires que quoi
que ce soit sur la région savoyarde et son Chablais où habitait Charles
Berssous. Son chansonnier donne plutôt le sentiment d'avoir été bâti par
un itinérant, officier par exemple, que par un vrai autochtone du monde
rural ou même urbain de la Savoie profonde. Lequel connaît moins le "vert
gazon", "le lys", "le jasmin" que sa prairie fleurie
à faner, le cyclamen ou la gentiane des pâturages. Néanmoins la chanson
sur les soldats valaisans à la bataille de Fontenoy apparaît bien comme
appréciée par un voisin frontalier.
Au XVIIIème siècle, tandis que Delille a donné avec ses jardins le chef d'œuvre de la poésie descriptive, que le prince de Ligne s'émerveille des beauté de son parc, la montagne ou le Léman sont pour maints auteurs et savants un lieu d'observations nouvelles et d'émotions. La relation de voyage, littéraire ou épistolaire, est alors illustrée par Saussure (Voyage dans les Alpes, 1779), Michaud (Voyage au Mont-Blanc, 1789), tandis que Rousseau, faisant le tour du lac de Genève, y conforte son engouement pour les paysages. En témoigne la Profession de foi du vicaire savoyard s'écriant : "La nature étalait à nos yeux toute sa magnificence".
Mais tout texte du recueil Berssous semble n'en avoir que faire, peut-être parce que même de passage dans un tel cadre le poète n'en sait pas voir peut-être aussi les inconvénients ni la réalité(17). La batelière n'est pas une barcarolle : l'orage sur les eaux tourmentées sert surtout de prétexte pour délacer le corset d'une belle évanouie aguichante. Les jardins décrits dans les chansons apparaissent plutôt comme des tapis et des écrins gazonnés, fleuris et abrités pour faire l'amour dans un confort naturel. C'est bien du jardin d'amour, substitut de l'ancien Verger d'amour du XVème siècle, dont on nous chante là quelques repères, pas nécessairement cohérents au point de vue botanique, climatique, biotopique. Le "vert gazon" d'une propriété anglo-normande, le "jasmin" méridional n'abondent pas ensemble dans le même territoire et à fortiori dans le savoyard. L'amant des pastorales dudit recueil manque de variété pour les fleurs qu'il offre, alors qu'il y en a tant en montagne : ce malheureux ne sait guère que porter son choix sur les roses et le lys d'Ile de France.
Le cadre fixé et convenu, comme dans un décor de théâtre, consiste, pour des plans éloignés, en un modelage de vallons et coteaux. Pas question de hautes montagnes, d'aiguilles et de dents rocheuses, de longues ou étroites vallées, de paysages enneigés et durs à pratiquer. L'orme est donc fréquent et absent tout conifère dans la flore d'un descriptif sommaire et stéréotypé qui implante pourtant l'élément obligatoire qu'est le bois ou plutôt le bosquet, parfois même la forêt (seulement quand le loup peut s'y cacher), et surtout le bocage - mais jamais l'alpage ou le pâturage - rimant pourtant tout aussi bien avec ramage, ombrage, feuillage. Enfin, en décor rapproché, apparaît l'arbre isolé et abri pour la conversation amoureuse.
L'amour donc, à lire notre chansonnier, ne se fait pas en été sur l'herbe à vache ou sur le foin de la grange. Ni dans le chalet chauffé par quelque poêle, alors que de 1600 à 1840 - voire après - la France, comme la Savoie, vécurent mal ce que les climatologues appellent "le petit âge glaciaire" avec des températures plus fraîches qu'aujourd'hui, des langues glaciaires développées et descendant dans les vallées, des villages engloutis par leur poussée et des montagnards qui ne cessaient de se plaindre. Mais les auteurs des chansons du manuscrit, eux, vivaient ailleurs confortablement.
(1) Mention d'un nom complètement raturé et illisible,
vraisemblablement par un troisième propriétaire ou contestataire de cette
seconde attribution.
(2) Mais nous verrons qu'il y eut en 1825, aussi, un autre
propriétaire, Claude H. Curtaz, de ce manuscrit.
(3) Parce que la parution dans des périodiques, mêmes spécialisés, peut
être postérieure de mois ou années à la première audition après composition.
(4) Soit dans les " Etrennes " éditées par Belin, Brunel, soit
par Gorgon fils, à Paris entre 1786 et 1789. Dito dans le Journal d'Amsterdam
ou choix de chansons françaises (Amsterdam, W.C. Nolting) de 1789
à 1806, ou dans le Journal hebdomadaire composé d'airs d'opéra
(op. cité), par Le Duc, à Paris, de 1786 à 1790.
(5) Op. cité, voir bibliographie générale.
(6) Mais pure hypothèse sur leur qualité relative quand, au début du siècle
le public littéraire se limite à quelques dizaines de milliers de personnes,
qu'une grande partie de la population ne parle en première langue qu'un
patois ou un dialecte local, et que sur 20 millions d'habitants, un tiers
à peine serait en mesure de lire le français. Cf. M. Kerautret, op. cité
en bibliographie générale.
(7) On verra dans le fac-similé ici produit en illustration quelques fautes
d'orthographe (actuel) dans La lettre de foi d'un vicaire savoyard
de J.-.J. Rousseau.
(8) J.-.M. Guyon, op. cité, p. 13., en bibl. gén.
(9) J. Mercier, L'abbaye et la vallée d'Abondance, Annecy, imp.
Neyrat, 1885, p. 296.
(10) Chanson 84.
(11) Groupe folklorique thononais, Hélas que je suis à
mon aise..
(12) J. Urbain, La chanson populaire dans la Suisse romande, op.
cité en bib. gén.
(13) S. Boll-Zemp, Le réenchantement de la montagne, Aspect du folklore
musical de la Haute Gruyère, 1992.
(14) Chansons savoyardes recueillies par E. Vuarnet, ouv. coll.,
1997, Maisonneuve et Larose éd., Paris 1997.
(15) A preuve de mêmes poèmes bien rédigés dans les recueils imprimés
de l'époque.
(16) L'insecte est demeuré la métaphore de l'intrus dans une locution
québécoise.
(17) Car c'est l'état d'esprit, dans la littérature du XVIIIème siècle,
d'estomper ou taire souvent les dures réalités matérielles.
