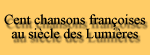
01
FANCHON REFUSE, MAIS...
(air non identifié)
FANCHON REFUSE, MAIS...
(air non identifié)
1
Fanchon dans ce beau vallon
Viens unir ta voix à ma musette
Pourquoi me répéter toujours "non" !
Laissons nos troupeaux à l'ombrage
Profitons du temps du rossignol sauvage
… Profitons de la saison
Viens, viens. N'appréhendez rien*.
Je suis un berger sage
Mon plaisir est de chanter ton nom
Fanchon (bis).
2
Berger fuyons le danger
Je ne te suis pas, je crains ma mère.
Berger fuyons le danger :
Maman me défend de m'éloigner,
Car si le loup rempli de rage
Dessus mon troupeau venait faire ravage
Qui pourrait me consoler ?
L'on dirait partout dans nos villages
Fanchon abandonne le verger.
Berger fuyons le danger, Berger… (bis).
3
Viens, viens, n'appréhendez(*) rien.
Bravons les discours du voisinage
Viens, viens, n'appréhendez(*) rien.
Nos troupeaux sont gardés par nos chiens.
Peut-on refuser un hommage
D'un berger discret
Tendre fidèle et sage,
Qui cherche tout pour nos biens ?
Promets moi la foi du mariage.
Donne-moi ton cœur et prends le mien.
Viens, viens (bis).
4
Non, non je n'y consens pas
A vous donner mon cœur
Je suis trop jeunette
Non, non je n'y consens pas
Vos discours flatteurs ne me tentent pas
Souvent j'entends dire à ma mère…
(*) Le z ne marque sans doute pas le pluriel de la deuxième personne en conjugaison, mais l'accentuation de la voyelle qui le précède, c'est à dire un e à prononcer.
Le trop plein d'un personnage mythique
Qui croirait débuter ce manuscrit par une chanson
typiquement savoyarde dont la fameuse Fanchon la vielleuse serait
l'héroïne sera dérouté : la présente n'y est qu'une bergère sage, dans
une variante de pastorale des pays de langue d'oïl.  Tout
au plus est-ce le berger compagnon qui joue de la musette, en invitant
la jeune fille à unir sa voix au son de l'instrument.
Tout
au plus est-ce le berger compagnon qui joue de la musette, en invitant
la jeune fille à unir sa voix au son de l'instrument.
La réelle prudence de la campagnarde n'est pas l'affectée qu'elle montre dans une autre chanson, notamment publiée par le Chansonnier français (1760-1762), et dont l'incipit, Fanchon, as-tu peur que je te touche (1), illustre comment l'héroïne fait mine de craindre que Lucas ne lui chiffonne son cotillon couleur de rose, car dès que ce dernier est ôté, elle badine sur son pucelage qu'elle a déjà perdu, puis retrouvé pour ce nouveau galant… Le médisant, autre titre (2) du même recueil, confirme aussi que la bergère rentre toute chiffonnée au logis, après une rencontre en cachette, mais avec Colas, sur une " herbette " de convention littéraire et qui n'a rien à voir avec l'herbe à vaches des montagnes de Savoie.
Pire, il y a le reproche de La Tulipe à Fanchon (3) qui accuse cette coureuse de faire la sucrée tout en le trompant avec une douzaine d'amants. Et le militaire refuse même d'endosser la paternité d'un bâtard qu'elle a eu d'un conseiller du roi ; il lui enjoint aussi de lui rendre son briquet et sa pipe.
Est-ce une fille à soldats ? Suzon, Fanchon, Nanette sont les filles citées dans une chanson nouvelle : Les adieux d'un soldat à sa maîtresse Suzon (4) (sur l'air de Chère Valenciennes) que le militaire fréquente vers 1757 dans les guinguettes et les Porcherons, ancien hameau de Paris qui fut un lieu de plaisirs au XVIIIème siècle. Même Servettaz note en Savoie dans Les chansons du soldat (5), L'enlèvement de la Fanchon laquelle fugue avec un beau dragon pour suivre son régiment, malgré père et mère alarmés.
Fanchon, diminutif de Françoise, apparaît au moins littérairement en 1680 (6) et même avant dans un Recueil de chansons pour boire et pour danser, édité en 1660 par R. Ballard (7), sous le titre de Fanchon a beaucoup d'envie. Et en 1705 Fanchon, Alison et Margoton sont le sujet d'un air à boire (8). Au cours du XVIIIème Fanchon va vivre différentes situations ou métiers au travers des paroles du temps. C'est une galante bouquetière dont on chante le joli corbillon (9), ou qui exerce seulement la profession d'écosseuse de la Halle, en 1767, dans un vaudeville de Taconet (1730-1774). Mais vers 1740, quand apparaît la mode du mirliton, coiffure féminine de cheveux courts roulés en boucles, Fanchon, dans une gravure de l'époque, est figurée en une chambrière ou bourgeoise à laquelle un courtisan tend le symbole d'une intimité conjugale souhaitée, un vase de nuit, accompagnant le geste d'un refrain rimé dans le branle du mirliton :
Si je vous donne un pot de chambre
Mon aimable Fanchon
C'est que j'ai le cœur tendre
Je vous le dit tout de bon
Cé pour le mirliton mirlitaine
Cette Fanchon là est habillée et coiffée à la mode parisienne, au pied de son immeuble ; elle n'a rien d'une pauvre campagnarde provinciale, émigrée et anachronique de tenue. Elle se différencie donc de l'héroïne de Jérosme et Fanchonnette, une pastorale en vers et en prose que Vadé crée en 1755. L'auteur y utilise en harmonie un langage populaire, plein de verve comique. L'œuvre a un franc succès, dont son air de Va, va, Fanchon, noté déjà en 1737 au Théâtre de la foire (10).
Comme la Fanchon du manuscrit Berssous, nombre de ses homonymes des chansons du XVIIIème siècle, dans sa première partie du moins, n'ont pas le métier de chanteuse de rue que l'on attribue à la plus célèbre des interprètes de ce temps là : Fanchon la vielleuse. Dans sa liste des références iconographiques sur elle, Florence Gétreau a intitulé sa collecte Construction d'un personnage mythique, à partir d'une douzaine d'exemples s'y rapportant, directement ou à travers des illustrations théâtrales, littéraires ou picturales :
Attribué au Chevalier Antoine de FAVERAY (1706-1791 ?), Fanchon la vielleuse et l'abbé L'Attaignant (?), vers 1775. Huile sur toile marouflée sur bois. 25x21.5. Musée Carnavalet.
La grâce de dieu, la rencontre à Paris. Estampe. H :310, L : 448, Atp, 57.175.140 C
La grâce de dieu, la folie. Estampe. H : 252, L : 337. Atp. 57.175.142 C
La grâce, en retour au pays. Estampe. H : 250, L : 337. Atp. 57.175.143 C
Marie quitte la Savoie. Estampe. H : 308, L : 448. Atp. 57.175.144 C
Marie reconnaît dans André le Marquis de Sivry. Estampe. H : 310, L : 448. Atp. 57.175.145.C
Marie devient folle. Estampe. H : 308, L : 448. Atp. 57.175.146 C
Fanchon la vielleuse. Estampe. H : 208, L : 345. Atp. 57.175.132 C
Mlle Clarisse. Estampe. H : 298, L :225. Atp. 57.175.1733 B
Carle VERNET (1758-1836), Madame Belmont [dans le rôle de Fanchon]. Estampe. H : 150, L : 108. Atp. 57.175.138 A (même estampe que 57.175.136 B, H : 275, L : 198)
Le concert enfantin. Estampe. H : 490, L : 388. Atp. 67.131.12 D
ANONYME, Joueuse de vielle à roue., début du XIXème siècle. Huile sur toile. 50x30. Montluçon. Musée des Musiques Populaires.
Louis LERAY PRUDENT, Portrait de Mme Belmont dans le rôle de Fanchon, Vaudeville, 1809, Peinture. 1853, Rouen, Musée des Beaux-Arts.
Histoire véritable de Fanchon la vielleuse, Paris, 1803. Atp. Bibl.
Car les vaudevilles et comédies qu'inspira ladite Fanchon ont, notamment, pour titre " Fanchon la vielleuse " par Bouilly et Pain, " La vielleuse du Boulevard " par Chaussier, " La Fanchonnette ", opéra-comique en 3 actes, représenté dès 1856, au théâtre lyrique, avec musique de Clapisson, " La fille de Fanchon " opérette en 4 actes, musique de Varney, paroles de Sevrat, Bumach et Fortuny. Ces deux œuvres eurent un grand succès, dès 1891 aux Folies dramatiques. De 1804 à 1811 il y eut une dizaine de pièces sur la même ambulante savoyarde et, en 1841, La grâce de Dieu, par d'Ennery et Gustave Lemoine.
On pourrait croire, avec autant de références que la biographie de Fanchon est bien assurée. Il n'en est rien et elle reste à reprendre. Pour A. Jal (11), Fanchon est née incontestablement à Paris le 14 mars 1737, dans la paroisse Saint Jacques du Haut-Pas , de Laurent Chemin, lui originaire du comté de Nice appartenant au Duc de Savoie. Fanchon épousa à 18 ans Jean-Baptiste Ménard le 10 février 1755 et mourut à Paris le 25 septembre 1780, rue de l'Arbre sec. C'est clair. Sauf que la morte, appelée fille Marie-Louise Chemin, est dite âgée de 45 ans, soit deux de plus qu'avec les précédentes dates, et ne porte pas le même prénom ni son nom de femme mariée !
Belle assurance contestée aussi par la tradition qui fait naître la Fanchon à Faverges, ce qu'écrit aussi Dufayard dans son Histoire de la Savoie. Or la consultation sur Minitel montre que, s'il n'existe pas de Chemin comme patronyme à Faverges même, il en demeure encore dans toutes les communes avoisinantes. Et ce nom prédestiné, voire approprié à un ambulant du chemin, tire l'appellation du gallo-romain camminus, mais aurait dû rester du type camin et ducamin s'il était vieux niçois et de langue d'Oc plutôt que de franco-provençal, où il est approprié ainsi.
Deux biographies anciennes de Fanchon datent de 1803 (12). Un des auteurs y récuse toutes les fantaisies et erreurs qu'il dit exister sur elle dans les œuvres théâtrales. Compte tenu de sa fréquentation de ladite Fanchon, il assure qu'elle est née à Faverges. Selon ce biographe le père de Fanchon était un Gérard François Thomas de Faverges, frotteur de Madame d'Arville. On ne sait pas s'il s'agit là d'un prénom dudit domestique ou de quelque patronyme. Et toujours selon le même biographe Fanchon épousa un certain Hippolyte Mascarti. Pour l'autre c'est une fille Morin, de Saint-Jean de Maurienne, qui convola avec le comte de Saint-Elme !
Trois noms, tant de célibataire que de femme
mariée, ne laissent même pas plus de certitudes sur le prénom ou les marraines
l'ayant donné. Pour un spécialiste en noms de famille Fanchon n'est que
le diminutif, en dialecte de l'ouest, du prénom de Françoise Chemin, alors
qu'en patois savoyard il aurait dû être Fanfouèze. Et selon un
biographe (13), Fanchon, en chantant et faisant marcher sa vielle, avec
un fichu sur sa tête, comme se coiffaient maintes provinciales ou paysannes,
par cet usage et son prénom donna le nom à ce type de fichu, désormais
appelé " une fanchon ".  Or
le mot étant repéré en français au début du XIXème siècle, comme coiffe,
la filiation n'est pas, non plus, très prouvée. Envisageons donc que Fanchon
soit seulement le diminutif de Françoise Chemin, voire qu'il y ait eu
plusieurs Savoyardes vielleuses, apparentées ou non, concourant à l'exaltation
du même mythe dans un siècle où l'on s'engoua pour les bergères, alpestres
ou autres, sans s'encombrer de détails réels, puisque des gravures la
prénomment même Marie ! Comme sa fille et sans doute bien d'autres interprètes
de chansons !
Or
le mot étant repéré en français au début du XIXème siècle, comme coiffe,
la filiation n'est pas, non plus, très prouvée. Envisageons donc que Fanchon
soit seulement le diminutif de Françoise Chemin, voire qu'il y ait eu
plusieurs Savoyardes vielleuses, apparentées ou non, concourant à l'exaltation
du même mythe dans un siècle où l'on s'engoua pour les bergères, alpestres
ou autres, sans s'encombrer de détails réels, puisque des gravures la
prénomment même Marie ! Comme sa fille et sans doute bien d'autres interprètes
de chansons !
Le plus célèbre des " tubes " sur quelque chanteuse ou vielleuse appelée Fanchon a le refrain bien connu : " Elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous ". Le timbre, d'un vaudeville plus ancien, avait déjà servi à l'abbé L'Atteignant, ami et contemporain de Voltaire et surtout auteur de chansons parfois légères. Sa mouture, datée de 1757, fut réécrite et attribuée au général A.-C. de Lassalle (14), en 1800 à Marengo : selon cet ultime texte Fanchon est une chanteuse parrainée par un Bourguignon et ayant eu une marraine bretonne, ce qui correspond au moins au régionalisme de son prénom, donné selon l'usage en principe par cette dernière. Le personnage du refrain est masculin chez L'Atteignant et féminin pour Lassalle !
Le tableau, attribué à de Faveray et nous montrant, au musée Carnavalet, peut-être Fanchon et l'abbé L'Attaignant, daterait des alentours de 1775. Il n'a donc pas la crédibilité indiscutable pour lui : l'abbé, retiré, atteint alors les 78 ans et Françoise Chemin 38 ans, âges où l'un et l'autre ne fréquentent plus ensemble les cabarets, par engouement ou professionnellement.
Voire les tripots ajoutent même des médisants, à partir de cette relation de Jal, où cette mère de plusieurs enfants (dont Laurent, Marie-Françoise, Jean-Pierre) Ménard, après maintes admonestations policières pour indécence et irrespect, à la suite d'une violente querelle de ménage avec son amant, le sieur Longuet, magistrat, et sur plainte de ce dernier, est condamnée à la prison, du 28 février au 13 mars 1769. Cette " Françoise Chemin, femme Ménard, dite Fanchon la vielleuse " est bien loin de la sage pucelle bergère du manuscrit Berssous ou de la " délicate et grande dame de MM. Bouilly et Pain " (15)!
En effet c'est par Bouilly, qui tenait la biographie de Fanchon du seul récit de sa tante, Madame Agiron, que la version édifiante de la vie de l'artiste de rue est connue (16). Fanchon y a logé rue de l'Arbre sec : or nous avons vu, à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois , qu'une Marie-Louise Chemin est effectivement décédée en cette rue le 25 septembre 1780. D'après Bouilly la demeure se situait en face d'un faïencier chez lequel se réunissaient, pour chanter et boire, les animateurs du Caveau. Le jeune écrivain " appelle toujours Fanchon " la belle Savoyarde ", persiste à la faire très riche et possesseur d'un hôtel " (17). Serait-ce à l'origine l'immeuble qui semble appartenir à son homonyme sur la gravure des années 1740 ? Jal ou C. Duneton (18) posent donc la question : " Qu'y-a-t'il de commun entre la " fille ", née vers 1735 et nommée Marie-Louise, et la femme Ménard, née en 1737, et nommée Françoise " en fonction du même prénom de sa marraine Françoise Bernard, c'est-à-dire de sa grand-mère originaire de " la Comté de Nice " selon le registre de baptême - mais bretonne si l'on en croit la version postérieure à la chanson de L'Attaignant qui fut leur contemporain. Sans oublier, pour cette recherche d'identité, la Fanchon dite originaire de Faverges !
Ou même d'autres chanteuses homonymes qui apparaissent à travers les chansonniers du XVIIIème siècle. Un Recueil de chansons galantes (19) en donne une qui décrit - mais déjà aux alentours de 1730 - donc avant que la légendaire vielleuse soit officiellement née - une Fanchon dont un admirateur loue l'aptitude vocale. C'est l'une des deux chansons, donnée avec la musique, en annexe sur Fanchon, ci-après.
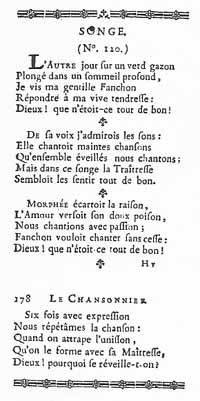

(1) Réédition Slatkine,
vol. II, air n°14 et 15, p.289, et paroles p. 230 données ci-après en annexe.
(2) Ibid., p.559-560, air n°115
(3) Ibid., p.246-247, air n°65 : Reçois dans ton galetas
(4) Recueil des plus belles chansons et airs de cour, A. Troyes, chez
Garnier, 30 mai 1757.
(5) Commentaire et présentation par D. Laborde et G. Delarue, CARE, Grenoble
1997. Chanson n°44, p. 98.
(6) A. Rey, Dictionnaire Historique de la langue française, Le Robert
éd., Paris 1992, t. 1, p. 777
(7) B.N. : Vm micr. 856.
(8) M° Boivin, Recueil d'airs de contredanse, B.N. : Vm74130(5).
(9) Bibl. Mazarine : Ms 3991. Corbillon, petite corbeille.
(10) P. Coirault, op. cité, p. 140.
(11) A. Jal, érudit (1795-1873) ; Dictionnaire critique de biographie et
d'histoire, 1867. Ses conclusions ont été reprises par F. Miquel ou J.
Mouthon dans la R.S., et C. Duneton dans son Histoire de la chanson française
(Seuil, 1998, t. I, p. 899 et s.).
(12) Consultables notamment au musée des A.T.P. Le second ouvrage a été publié
par Capelle et Girard en 1803.
(13) J. Mouthon dans la R.S.
(14) Selon Dumersan (1780-1849). Le timbre restait celui de Amour laisse
gronder ta mère. Ch Malo, qui fut à partir de 1812 l'éditeur des Etrennes
lyriques et anacréontiques (fondées en 1781) donne comme référence
: Clé du Caveau, n°1073, 1798, par le comte de Lassalle. Références
dans Anthologie de la chanson française, par P. Vrignault, Paris,
Delagrave, 1926, p. 277-279, et Aux sources des chansons populaires
par M. David et A.-M. Delrieu, Belin éd., 1984. Le Chansonnier François,
1760-1762, t.v., p. 176, air n°128, donne l'air et le poème les plus anciens.
(15) C. Duneton, op. cité, à partir de Jal, op. cité.
(16) Mes récapitulations (1837, 3 vol., in 12).
(17) C Duneton, op. cité.
(18) Ibid.
(19) t. II, p. 240 avec timbre dont l'incipit est
: L'autre jour sur un vert gazon. Ce recueil du XVIIIème enchaîne
chronologiquement les chansons notées. En réserve, au département de la
musique, B.N. Richelieu. La même chanson est reproduite au Chansonnier
français, rééd. Slatkine, op. cité, p. 419, air n° 120., ou texte
donné ci-dessus.

