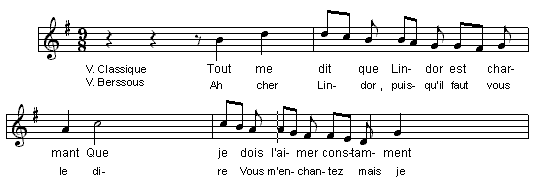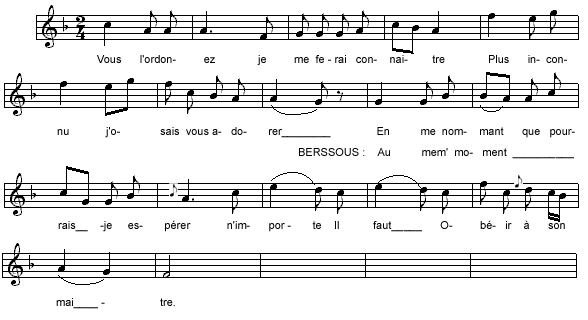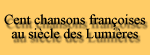
06
- JE SUIS LINDOR !
- CESSEZ LINDOR...
- JE SUIS LINDOR !
- CESSEZ LINDOR...
1
Vous l'ordonnez je me ferai connaître
Plus inconnu j'osais vous adorer.
Au même moment que pourrais-je espérer ?
N'importe il faut obéir à son maître.
2
Je suis Lindor, ma naissance(1) commune
Mes vœux sont ceux d'un simple bachelier.
Que n'ai-je hélas d'un brillant chevalier
A vous offrir le rang et la fortune.
3
Tous les matins ici d'une voix tendre
Je chanterai mon amour sans espoir.
Je bornerai le plaisir à vous voir,
De vous prouver ce que vos traits m'inspirent(2).
(1) Il manque le "est", nécessaire
autant à la métrique qu'à la syntaxe.
(2) Vers différents dans la version classique :
Je bornerai mes plaisirs à vous voir,
Et puissiez-vous en trouver à m'entendre !
4
Ah cher Lindor, puisqu'il faut vous le dire(3)
Vous m'enchantez mais je suis sans pouvoir
Je ne puis vous accorder que l'espoir
De vous prouver ce que vos traits m'inspirent.
5
Vous le voyez il est bien impossible.
Puis-je forcer ces portes, ces verrous ?
Votre entretien, vos accents sont si doux
Qu'en vous voyant je deviens trop sensible.
6
Cessez Lindor, cessez votre guitare
J'entends quelqu'un dans mon appartement
C'est mon tuteur ; dans un autre moment !
Mais malgré lui que rien ne nous sépare.
(3) La réponse de Rosine, dans la pièce classique,
se limite à :
Tout me dit que Lindor est charmant,
Que je dois l'aimer constamment…
"Les différents états d'un texte sont
comme les métamorphoses de l'insecte"
(F. Grendel)
Lindor, personnage de la comédie italienne, dont le cadre théâtral est ici suggéré par quelques détails architecturaux, visibles du spectateur (porte, verrou, appartement), intervient dans un décor typique de places et maisons abritant des amours contrariées : il figure le type de l'amoureux espagnol qui soupire en s'accompagnant de la guitare sous les fenêtres de sa belle. Dans le Barbier de Séville c'est le personnage enveloppé de la cape hispanique d'un abbé, sous laquelle se dissimule le comte Almaviva, qui chante la romance de Lindor : il est épris de Rosine, pupille du vieil avare et jaloux médecin Bartholo qui la séquestre et compte bien l'épouser. Mais voici que le jeune comte rencontre heureusement son secoureur, Figaro, qui fut jadis à son service et s'est finalement installé comme barbier à Séville. Avec lui Beaumarchais a créé un véritable type d'homme populaire, instruit, éclairé, débrouillard, qui réclame un peu plus de justice sociale et qui, par son intelligence et son activité au service d'autrui ou d'Almaviva, même en ayant caractère frondeur, cynique de paroles et sentimental de cœur, bref en vrai enfant de Paris, mérite un rôle dans les destinées de la nation.
Les personnages sont d'ailleurs tous pris dans la société française du XVIIIème siècle. Rosine en est : toujours mignonne et mutine, elle sait ce qu'elle veut. Cette petite noble entend être femme libérée, au moins dans son amour avec le comte Almaviva, heureux de l'épouser, n'ayant lui jamais eu d'autre état que de courir après le fruit défendu.
Rien de surprenant que Beaumarchais ait voulu
exploiter la signification moqueuse du nom d'un Figaro, qui se permet
de mépriser les plus aisés qu'il sert, ne craignant pas de répliquer au
comte : "Aux vertus qu'on exige d'un domestique, votre excellence connaît-elle
beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets ?"(1) Aussi le
Barbier de Séville, annoncé par affiche de la Comédie-Française
le 12 février 1774, fut-il interdit et ne put-il être présenté qu'un an
plus tard, le 23 février 1775.  Le
porte-parole de Beaumarchais, Figaro, n'y lançait contre la noblesse que
quelques traits légers qui n'étaient, comme ci-dessus, encore que du persiflage,
mais avec l'art des formules qui font mouche. La satire politique et sociale
plus amère réapparut autrement nette dans le Mariage de Figaro ou la
folle journée, composée la même année mais remise aux comédiens en
1781. Puis pendant trois ans Louis XVI en interdit la représentation.
Sous la pression de l'opinion publique, de la cour, du Comte d'Artois,
de la Reine même, la pièce fut jouée le 27 avril 1784. Ce fut un triomphe
dont l'enthousiasme des spectateurs a fait dire : "Ce jour là, la Révolution
était commencée". Beaumarchais écrit d'ailleurs ironiquement au baron
de Breteuil : "Dans le Barbier de Séville, je n'avais qu'ébranlé l'Etat,
mais dans le nouvel essai plus séditieux, je le renverse de fond en comble".
Le
porte-parole de Beaumarchais, Figaro, n'y lançait contre la noblesse que
quelques traits légers qui n'étaient, comme ci-dessus, encore que du persiflage,
mais avec l'art des formules qui font mouche. La satire politique et sociale
plus amère réapparut autrement nette dans le Mariage de Figaro ou la
folle journée, composée la même année mais remise aux comédiens en
1781. Puis pendant trois ans Louis XVI en interdit la représentation.
Sous la pression de l'opinion publique, de la cour, du Comte d'Artois,
de la Reine même, la pièce fut jouée le 27 avril 1784. Ce fut un triomphe
dont l'enthousiasme des spectateurs a fait dire : "Ce jour là, la Révolution
était commencée". Beaumarchais écrit d'ailleurs ironiquement au baron
de Breteuil : "Dans le Barbier de Séville, je n'avais qu'ébranlé l'Etat,
mais dans le nouvel essai plus séditieux, je le renverse de fond en comble".
Si Mozart a composé un opéra-comique sur le Mariage de Figaro (1786) et Rossini un sur le Barbier de Séville (1816 à Rome, 1819 à Paris), c'est à Dezède (1740-1792), compositeur pour le théâtre d'une vingtaine d'ouvrages, qu'est attribué un des airs célèbres du Barbier de Séville de Beaumarchais : "Je suis Lindor". Néanmoins la Clef du Caveau donne aussi une variante du timbre par Paisiello (1740-1816), compositeur italien et auteur de nombreux opéras (Il Re Teodoro en 1784, Nina en 1787, La belle meunière en 1788) ainsi qu'un Te Deum pour le couronnement de Napoléon. Paisiello, maître de chapelle de l'impératrice Catherine II à Saint-Petersbourg, y présenta le 26 septembre 1782 un Barbier de Séville qui restera très populaire en Italie(2) jusqu'à la création du chef-d'œuvre de Rossini en 1816, sur un livret de Sterbini. Mais alors une dizaine d'opéras et un ballet se sont déjà inspirés du Barbier ! L'un d'entre eux, la version française de l'œuvre de Paisiello, expliquerait-elle l'extrait du manuscrit Berssous ?
Il existe une controverse concernant l'attribution de la musique à Dezède. En juin 1777 la Correspondance littéraire(3) cite le compositeur par un témoignage indirect : "Il y a longtemps qu'aucun opéra-comique n'avait eu le succès des Trois Fermiers, […] Les paroles sont de M. Monvel, […] la musique de son ami M. Dezède, qui a déjà fait […] les airs du Barbier de Séville de M. de Beaumarchais".
Or les deux timbres populairement retenus et proposés par la Clé du Caveau pour porter les strophes du Comte et de la Reine dans la scène VI de l'acte II permettent, pour des quatrains dont la métrique enchaîne vers de 11, 10, 10, 11 syllabes, de vérifier que la correspondance musique-paroles coïncide aussi bien avec l'air de Dezède qu'avec l'autre de Paisiello, conçu en 1782. Sauf pour la première strophe du manuscrit Berssous, donnée ci-jointe sur la partition de Dezède, où la longueur de son deuxième vers peut éventuellement s'adapter mieux à celle de la séquence mélodique plus étirée. Reste que le libellé "Au même moment que pourrais-je espérer", malgré l'allongement métrique satisfaisant dans cette unique strophe, quand on compare ledit vers à la moins longue formule rédactionnelle des autres versions, où toutes identiquement portent "En me nommant que pourrais-je espérer", fait envisager davantage une erreur de transcription du recueil Berssous qu'une avant-première, originale et perfectible de Beaumarchais(4). D'autant que le quatrième vers de la troisième strophe semble encore plus fautif puisque sa syllabe finale ne rime nullement avec celle du premier et que son libellé est tout autre.
Encore que ce quatrième vers permet ainsi la réponse de la bergère au berger dans l'identique que fait Rosine, très vraisemblablement sur le même timbre, tant la structure métrique de sa propre chanson s'adapte à la précédente. Les trois strophes ici chantées par la jeune fille ne se retrouvent dans aucun des manuscrits connus ou de première édition du Barbier. Par ailleurs elle s'y affiche ostensiblement amoureuse par la déclaration des deux premiers vers "Ah, cher Lindor…" alors qu'elle est plus discrètement explicite dans le fredon allusif du Maître en droit de la pièce classique, dont nous reparlerons ci-après.
A l'incertitude sur le travail de Dezède s'ajoute, la renforçant, une paternité toute autre, explicitée par l'un des deux commentaires manuscrits sur l'une des deux partitions du Barbier que possède la BN(5) . "Par M. de Beaumarchais, paroles et musique", noté en page de titre. Dezède serait-il alors étranger à tout timbre de la pièce, ou n'avait-il que modestement collaboré à l'orchestration des mélodies dont la présente, notamment, qui était accompagnée par un ensemble d'instrumentistes?
Comment Dezède s'intéressa-t-il, lui, au même sujet théâtral? Beaumarchais avait écrit, après, en 1765, une ébauche titrée Le Sacristain(6), aux nombreuses ariettes, préfigurant le texte sinon la musique d'un opéra-comique intitulé le Barbier de Séville, daté de 1772 ; mais sur le refus de l'un des acteurs de la Comédie Italienne auxquels il l'avait présenté, il l'avait transformé en une comédie que le Théâtre-Français s'était empressé d'accepter. Or c'est justement à partir de 1772 que Dezède commence sa série d'opéras et d'opéras-comiques, la plupart pour la Comédie Italienne. Dezède a d'ailleurs laissé un manuscrit, Le véritable Figaro, qui confirme son inspiration musicale pour le personnage de Beaumarchais.
On a parfois affirmé, et sans invraisemblance, que ce dernier était l'auteur véritable de la musique du Barbier, laquelle serait fondée sur des airs espagnols et italiens rapportés d'Espagne lors du voyage de Beaumarchais en 1764-1765. Car, en cet art, l'écrivain ne manquait pas de talent. "Il avait eu l'honneur, en 1769, de donner des leçons de harpe aux filles de Louis XV ; lui-même pratiquait plusieurs instruments et avait composé des chansons. En 1787, il fera représenter avec succès un opéra, Tarare, sur une musique de Salieri, avec lequel il collabora étroitement". Une sensibilité qui fera ainsi se décrire Beaumarchais dans la Lettre modérée : "Moi qui ai toujours chéri la musique sans inconstance et même sans infidélité…" Mais, selon une indication de l'Almanach musical de 1776, la musique du Barbier serait due à Baudron, premier violon de la Comédie Française. Le fait est assuré pour la musique de l'Orage, entre le IIIème et le IVème acte. Pour les chansons, il est très probable que Baudron et Beaumarchais ont travaillé ensemble, celui-là orchestrant les airs que celui-ci avait en tête depuis son opéra-comique. Les partitions du Barbier existent à la Bibliothèque Nationale… Pour la réponse de Rosine, Beaumarchais emprunte le début d'une ariette du Maître en droit de Monsigny et Lemonnier (1760). Cet opéra bouffe exploitait une situation comparable à celle du Barbier, et l'amant y est un bachelier du nom de Lindor. En adoptant ce prénom, le comte s'est donc référé le premier au Maître en droit ; par le choix de sa chanson, Rosine montre qu'elle a compris l'allusion et qu'elle connaît bien, elle aussi, cet opéra-bouffe. Cette rencontre sur le plan musical est l'une des manifestations de leur complicité. D'autre part, le procédé de la citation permet à Rosine d'exprimer ses sentiments sans enfreindre les règles de la bienséance. Le spectateur de 1775 partage la même culture musicale et son plaisir vient de cette connivence. Aujourd'hui où le Maître en droit n'est plus connu du public, le metteur en scène devrait logiquement, pour rester fidèle à l'esprit de cette scène, substituer à l'ariette de Rosine un air à la mode, adapté à la situation, et modifier en conséquence le deuxième couplet du comte…"(7).
Partition Monsigny
Partition Paisiello
Partition Dezède
A cette analyse actualisée de P. Testud s'ajoute celle qu'il fait sur la guitare qui entre en jeu dans cette scène 6. Cet instrument de musique, introduit en Espagne par les Arabes, est devenu, durant le XVIIIème siècle, du fait de sa petite taille et de son coût peu élevé, très populaire dans les deux péninsules italienne et espagnole, en Autriche aussi, et comme instrument de salon en France, où les gravures, au moment de la Révolution, le montrent dans les mains de joueuses. Et en 1788, Monsieur Lévrier de Champ-Rion écrit un poème à la gloire de ce nouvel instrument, chanté sur l'air du Menuet d'Exaudet, avec pour titre, La guitare(8).
Dans le Barbier "Figaro prête sa guitare au comte pour qu'il puisse s'accompagner dans sa réponse chantée à Rosine. La musique a été fournie par le papier tombé du balcon (I,3). La partition montre qu'en fait le comte fait seulement semblant de jouer : c'est l'orchestre qui l'accompagne, en imitant, par le pizzicato des cordes, le son de la guitare. La voix elle-même est doublée, selon l'usage de l'opéra-comique, par un instrument à vent (flûte ou basson, selon les passages). Cette chanson est bien intégrée dans l'action : son existence même est le signe de la difficulté de communiquer avec Rosine ; elle exprime aussi l'enjeu sentimental de la comédie (la musique est le langage du cœur) et, par le mensonge sur le bachelier Lindor, prépare la suite. Elle est également liée à la gaieté de la comédie. D'abord par les interventions de Figaro après chaque couplet : Beaumarchais a fragmenté la continuité du morceau musical afin de ne pas laisser envahir sa comédie par une tonalité trop sérieuse et trop tendre…"(9).
Cette science du découpage de scénariste importait-elle autant au collecteur de la Chapelle d'Abondance ? C'est le morceau de bravoure musicale, le "tube" dirions-nous aujourd'hui, qu'il nous a, sans plus ni dialogues, conservé et transcrit sur son manuscrit. En en faisant disparaître les commentaires de Figaro entre les couplets ? Rien ne permet de le dire dans la mesure où le texte chablaisien diffère du texte classique du Barbier, tel que ce dernier est aujourd'hui joué, enseigné, chanté. Ainsi l'ultime vers du troisième couplet du comte ne se retrouve pas identique pour la comparaison, et la réponse de Rosine que porte le manuscrit savoyard, non seulement est bien plus longue (en trois strophes au lieu de deux vers), mais elle ne peut être chantée sur l'air du Maître en droit, associé à un nombre de syllabes inférieurs par séquences musicales. Les interruptions de Figaro dans l'enchaînement des répliques peut relever aussi de semblables différences d'un texte souvent remodelé par un perfectionniste : Beaumarchais. L'écrivain, en définitive, usera avec discrétion de la citation musicale retenue. Le couplet est vite interrompu, au bout de deux vers, par une fenêtre qui se ferme. La musique, ainsi réduite, se trouve étroitement liée à l'enfermement de Rosine et n'a plus rôle d'ornement alourdissant.
Peu est connu le prototype où l'auteur s'essaye, où il va pouvoir allier deux de ses passions : la musique et la comédie. Certes le Barbier de Séville, opéra-comique, est la première version de la pièce, achevée en 1772, mais perdue depuis. On sait seulement que la musique, bâtie à partir d'airs espagnols et italiens collectés par Beaumarchais, rendait l'œuvre fort gaie.
Comment l'écrivain persévera-t-il après le refus des Comédiens-italiens ? Il y eut : "Le Barbier de Séville, comédie en 4 actes : Beaumarchais transforme son opéra-comique en comédie. Il semble bien que, tout en conservant l'intrigue, il ait réécrit son texte, destiné cette fois aux Comédiens-français"(10), mais des contretemps retardèrent la représentation.
"Le Barbier de Séville, comédie en 5 actes : ces contretemps sont mis à profit pour des retouches, dont l'ampleur va jusqu'à grossir la pièce d'un acte supplémentaire. Représentée enfin le 23 février 1775, elle essuie un échec complet.
"Le Barbier de Séville, comédie en 4 actes : selon son habitude, Beaumarchais réagit aussitôt… Dès le 26 février, une nouvelle version en 4 actes est prête : cette deuxième représentation est un succès. Admirable redressement de situation, dû à la vivacité d'esprit, à l'habileté du dramaturge, mais aussi au respect que celui-ci porte au jugement du public : l'écriture théâtrale reste toujours pour Beaumarchais une écriture provisoire, inachevée, tant qu'elle n'a pas subi l'épreuve de la représentation"(11).
Le spécialiste dudit écrivain et de son Barbier de Séville saura trouver à quelle étape de la genèse de pièce, l'auteur du recueil Berssous en a collecté le morceau qui lui convenait ou s'il s'agit d'un prototype original de ladite œuvre. Peu après cette transcription sur le manuscrit savoyard daté par un tardif propriétaire le 29 mai 1799, Beaumarchais, rayé de la liste des émigrés dès 1796, a pu revenir en France et y mourir peu avant, à savoir le 18 mai 1799, dans sa maison située près de la Bastille.
Bibliographie
- L'édition de référence du Barbier de Séville est la commune aux Classiques Larousse (1992) présentée par P. Testud, et à la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard 1988) : c'est le texte donné pour la dernière des éditions faites en 1775.
- Les partitions du Barbier de Séville sont disponibles à la Bibliothèque Nationale, département de la Musique, référence Rés. F 1124A et Rés. F 1124, et VmcG159 ou Vm 74827 p.115.
L'histoire compliquée, en plusieurs étapes, de la genèse du Barbier de Séville se trouve dans :
- E.-U. Arnould, La genèse du Barbier de Séville, Dublin, University Press, Paris, Minard, 1965, cote Fol YF 208 Support imprimé, Rez de jardin de la BNF.
- R. Pomeau, Le Barbier de Séville, de l'intermède à la comédie, Revue d'histoire littéraire de la France, nov.-déc. 1974, n°6, p. 963-975.
- J.-P. de Beaumarchais, Un inédit de Beaumarchais : le Sacristain, ibid., p. 976-999.
Les manuscrits du Barbier de Séville sont au nombre de trois : deux sont à la bibliothèque de la Comédie Française et le troisième appartient à la famille des descendants directs de Beaumarchais. Leur examen critique est fait par E.-J. Arnould, op. cité, qui présente, p. 123 et s., le tableau récapitulatif des principales variations des manuscrits et de l'édition de l'œuvre dont, pour la partie à comparer avec le texte du manuscrit Berssous, les p. 190 et s.. Sur Beaumarchais et sur les ébauches qui annoncent le Barbier, voir l'ensemble de l'œuvre publiée dans la Pléiade, op. cité, et aussi, de J.-P. de Beaumarchais, Beaumarchais, le voltigeur des Lumières, Coll. Découvertes Gallimard, 1996 ; plus l'étude citée en note.
(1) Le barbier de Séville, Acte I,
sc. II
(2) n° 642, le n°640 étant celui de Dezède que nous complétons ci-après
par les paroles Berssous. L'opéra de Paisiello sera joué en français en
1784, dans une adaptation de Framery.
(3) Juin 1777, t. IX, p. 483
(4) Mais le moment, l'instant où bascule en permanence le temps
qui règle le monde et l'événement, a pu être une donnée importante que
l'horloger inventeur qu'était Beaumarchais a volontairement associé au
brusque changement de nom du Comte.
(5) B.N. Richelieu. Dpt Musique, Rés. F1124.
(6) J.-P. de Beaumarchais, Un inédit de Beaumarchais, Le Sacristain,
Revue d'histoire littéraire de la France, 74ème année, nov.-déc. 1974,
n°6, p. 976-999.
(7) P. Testud, Beaumarchais : le Barbier de Séville, Classiques
Larousse, 1992, p. 201 et s.
(8) G. et G. Marty, Dictionnaire des chansons de la Révolution,
Tallandier éd., Paris, 1988, p. 20.
(9) P. Testud, op. cité, p. 203.
(10) Ibid., p. 13.
(11) Ibid., p. 13.