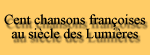
29
TIRCIS AU TOMBEAU, LISETTE LE SUIVRA BIENTÔT
TIRCIS AU TOMBEAU, LISETTE LE SUIVRA BIENTÔT
1
Dans le fond d'un bocage,
Lisette soupirant,
Entourée de feuillages,
Pleurait amèrement.
Assise dessus l'herbette
Dans les tristes forêts
Entretenait seulette
L'écho de ses regrets.
2
La belle, de l'amante
En déclarant ses maux
Pour les pleurs elle augmente
Le coulant des ruisseaux
Les échos de la plaine
Témoins de son malheur
En retirant la peine
Répétant sa douleur.
3
Tircis le plus fidèle
Des bergers du hameau,
Qu'en vain ma voix appelle,
Gardait là son troupeau
Un bouquet de violettes
Me donnant chaque jour
Et souvent en cachette
Des baisers pleins d'amour.
4
Tircis est mort, que faire ?
Mes yeux versent des pleurs.
Fleurettes pour me plaire
Changez votre couleur.
Plaintive tourterelle,
Rossignol charmant,
Et vous échos fidèles
Respectez ma douleur.
5
Allez à l'aventure
Pauvres petits agneaux.
Cherchez votre pâture
Dans ces tristes coteaux.
Oui je vous abandonne
Tircis est au tombeau,
Que rien ne vous étonne,
Je le suivrai bientôt.
1
Au lever de l'aurore,
Sur un tapis de fleurs,
Zéphyr caressant Flore,
Climène toute en pleurs,
Assise sur l'herbette
A l'ombre d'un cyprès
Contait ainsi seulette
Aux échos ses regrets
2
Le rossignol sauvage
Quittant les sombres bois,
Suspendait son ramage
Pour entendre sa voix.
L'onde dans la prairie
Plus lentement coulait,
Pour ouïr l'harmonie
De son doux flageolet.
3
Tircis fut le modèle
Des bergers du hameau.
Discret, sage, fidèle,
Soignant bien son troupeau ;
Cueillant les violettes,
Donnant dans les vergers
Aux agneaux des fleurettes,
Puis à moi des baisers.
4
Tircis est mort ; bergère,
Donne cours à tes pleurs ;
Fleurs, quittez, pour me plaire,
Brillantes couleurs.
Plaintives tourterelles
Rossignols si charmants
Et vous échos fidèles
Répétez mes accens
5
Errez à l'aventure ;
A la merci des loups,
Cherchez votre pâture,
Moutons, dispersez-vous
Je plains votre misère ;
Mais Tircis m'est ravi,
Et sa triste bergère
L'aura bientôt suivi(1)
(1) NDLR ; en italique les strophes, telles que numérotées, du Chevalier de Boufflers, et mises en parallèles des homologues du chansonnier Berssous.
Un problème de langage et de vocabulaire sur de la musique
Lisette, par son prénom traditionnel comme soubrette de comédie, intrigante et délurée, est aujourd'hui le type de jeune femme du peuple, gaie, légère, insouciante, créée par les chansonniers et les poètes. Mais avant que Béranger en ait fait le modèle de la grisette parisienne, elle apparaît dans la chanson du 18ème siècle comme une jeune amoureuse de campagne moins légère qu'il n'y paraît, à en croire ses propos de détresse lors de la mort de son amant.
Lui porte nom tout autant allégorique. Le berger sicilien Thyrsis, ou Tircis, maître en l'art du chant bucolique, apparaît avec les Idylles, poème de Théocrite, un grec de l'époque alexandrine qui célébrait l'amour dans un décor pastoral et champêtre, avec un sentiment de la nature et une fraîcheur d'inspiration s'y alliant au réalisme. Sinon avec naturel, du moins le principe du modèle antique est-il ici respecté, d'autant que le thyrse, dont l'amant tire son prénom, était constitué par une tige surmontée d'une pomme de pin, d'un bouquet de feuilles de vigne ou d'une touffe de lierre. On y ajoutait parfois un ruban noué. Dans la présente chanson, Thyrsis offre d'ailleurs bouquet à Lisette : un assemblage de violettes, symbole de modestie qui convient au berger… et à sa bergère, et en rappel du thyrse signifiant la vie et la fécondité. La mort de Thyrsis semble donc une réelle catastrophe, à partir de références littéraires et mythologiques, qui devaient êtres ignorées des gens du peuple, au 18ème siècle, qu'ils soient parisiens ou / et savoyards.

Les deux chansons du 18ème siècle, celle présente du Chansonnier Berssous et celle du Chansonnier françois dont nous fournissons la partition(1), n'ont de commun que l'incipit. Malgré des textes et airs qui diffèrent, une parenté demeure : Lisette y est remplacée par Phyllis, une princesse thrace qui, désespérée d'avoir perdu son amant, fils de Thésée, se pendit et fut changée en amandier.
Toute la problématique poétique dont on controverse au 18ème
siècle est illustrée par le style un peu emprunté de ce thème sentimental
dans un contexte campagnard :  la
poésie ne peut se justifier comme langage de la communion des cœurs que
s'il y a compatibilité entre cette communion et quelque forme que ce soit
de rationalisme poétique, car si ce langage spécifique ne fait que porter
atteinte à l'intelligibilité du message, et si l'intelligibilité est la
loi exclusive des productions de l'esprit, alors au diable cette poésie
! L'idée d'une sorte d'inutilité (sinon nuisance) décorative du langage
poétique a été une constante de la critique littéraire du 18ème siècle(2).
En 1784, dans son Discours sur l'universalité de la langue française,
l'extrémiste Rivarol voit dans une sorte de caractère antipoétique son
plus beau fleuron : "Ce qui distingue notre langue des langues anciennes
et modernes, c'est l'ordre et la constitution de la phrase. Or cet ordre
si favorable, si nécessaire au raisonnement est presque toujours contraire
aux sensations, qui nomment le premier objet… Le français, par un privilège
unique, est seul resté fidèle à l'ordre direct, comme s'il était toute
raison, et on a beau, par les mouvements les plus variés et toutes les
ressources du style déguiser cet ordre, il faut toujours qu'il existe
; et c'est en vain que les passions nous bouleversent et nous sollicitent
de suivre l'ordre des citations : la syntaxe française est incorruptible".
la
poésie ne peut se justifier comme langage de la communion des cœurs que
s'il y a compatibilité entre cette communion et quelque forme que ce soit
de rationalisme poétique, car si ce langage spécifique ne fait que porter
atteinte à l'intelligibilité du message, et si l'intelligibilité est la
loi exclusive des productions de l'esprit, alors au diable cette poésie
! L'idée d'une sorte d'inutilité (sinon nuisance) décorative du langage
poétique a été une constante de la critique littéraire du 18ème siècle(2).
En 1784, dans son Discours sur l'universalité de la langue française,
l'extrémiste Rivarol voit dans une sorte de caractère antipoétique son
plus beau fleuron : "Ce qui distingue notre langue des langues anciennes
et modernes, c'est l'ordre et la constitution de la phrase. Or cet ordre
si favorable, si nécessaire au raisonnement est presque toujours contraire
aux sensations, qui nomment le premier objet… Le français, par un privilège
unique, est seul resté fidèle à l'ordre direct, comme s'il était toute
raison, et on a beau, par les mouvements les plus variés et toutes les
ressources du style déguiser cet ordre, il faut toujours qu'il existe
; et c'est en vain que les passions nous bouleversent et nous sollicitent
de suivre l'ordre des citations : la syntaxe française est incorruptible".
Si sujet, verbe, complément, devaient être la seule structure du message, selon l'outrance de Rivarol, la deuxième strophe de la chanson en serait l'antithèse parfaite par le nombre d'inversion des termes et l'inappropriation d'un participe présent à la place de l'indicatif dans la conjugaison du dernier vers. A la seule lecture difficile du texte on applaudirait le puriste littérateur et célèbre journaliste. Mais en chantant la strophe, selon la correspondance des vers et rimes avec les lignes mélodiques et leurs finales, la fluidité du texte passe d'une autre manière, en fonction des règles d'harmonie entre la langue et la musique : la deuxième syllabe du participe "répétant" tombe sur une courte note et fraction de mesure alors que la logique grammaticale de l'indicatif "répètent" aurait nécessité qu'une plus longue la porte. Nous sommes là dans le cas des verbes en -eler et -eter où s'exerce le déplacement de l'accent tonique, expliquant les modifications d'orthographe et de son avec une tendance, dans les langues latines et romanes, au triomphe de l'accentuation sur la quantité. Pour le dit vers, compte tenu du timbre, avec une longue première note, il fallait nécessairement pour la deuxième syllabe du mot faire coïncider avec la note suivante du moins l'inflexion courte du participe verbal, plutôt que la longue de l'indicatif qui aurait été en désaccord avec le rythme de la séquence mélodique.
La parole, quand elle exprime l'idée au moyen d'images et du langage rythmique qu'exalte le sentiment suggéré par le son, c'est-à-dire quand il s'agit d'une poésie chantée résout mieux le dilemme posé par les critiques du 18ème siècle, et justifie même d'apparentes erreurs de libellé. A partir du Chansonnier françois (n°3 ), la partition avec adaptation volontariste des paroles de la 1ère strophe du chansonnier Berssous, illustre le propos.
Mais la correspondance musique - paroles n'est pas toujours idéale selon les vers et les strophes. On ne sait s'il s'agit d'erreurs de transcription du texte ou d'une difficulté à lui adapter tel ou tel vaudeville peu ou prou de même coupe, du style Oh ma tendre musette, Il pleut, il pleut bergère, etc… Reste que malgré la communauté du seul incipit de deux chansons ou la similitude de leur sujet, le texte du manuscrit Berssous, pour le gros des paroles, évoque exclusivement deux œuvres apparentées, aux libellés quasi identiques, et chansons ayant au moins une partition musicale propre, différente de la susdite, voire deux. Longue histoire !
En effet cette chanson 29, par ses vers, diverge très peu de celle due au Chevalier de Boufflers, parue en 1790, dans les Etrennes lyriques et anacréontiques. Il s'agit là de deux moutures voisines d'une version, en principe authentique, en langue gasconne, donnée dix ans plus tôt, en 1780, par Laborde(3)! Ce musicologue et compositeur avait d'ailleurs porté sur la partition les vers vernaculaires de même sens, tout en donnant en annexe un poème libre qui différait tant de l'original que des proches paroles du manuscrit Berssous ou du Chevalier de Boufflers. C'est que la transcription d'une chanson dialectale du sud-ouest dans la langue de Voltaire pose le difficile problème d'un nombre différent de syllabes à faire coïncider avec la structure du timbre. Aussi est-il intéressant de voir dans quel sens, avec quel brio ou liberté, chaque traducteur a tiré et modifié les paroles pour les besoins d'une superposition correcte.
Le libellé Berssous a par exemple popularisé l'héroïne en Lisette alors que celui du Chevalier de Boufflers a conservé l'originel prénom de Climène, laquelle ne paraît pourtant pas davantage rurale que dans la (prétendue ?) version gasconne, très française du XVIIIème siècle par ses conventions parisiennes, malgré la coloration et la syntaxe régionales du propos. Le chansonnier savoyard remplace aussi le funéraire cyprès d'un décor convenu par des "tristes forêts" passe-partout, aux essences moins typiquement méridionales. Et le Chevalier de Boufflers, lui, conserve même le zeste (est-il gascon ?) de mythologie antique qu'introduisent Zéphyr et Flore. Son texte est d'ailleurs le mieux bâti, encore que transcrivant surtout un texte vernaculaire, le mérite reste relatif. Et ce rimeur de "guimauve" (dixit Duneton !) propose par contre pour la chanson le timbre de De mon berger volage, laquelle a du aussi l'inspirer pour son proche texte, car Tircis y joue du flageolet comme le pastouriau de cette célèbre chanson.
Les vaudevilles, on le voit par cet exemple, sont alors construits pour être réutilisables et interchangeables, car porteurs de mêmes coupes poétiques et mélodiques, systématisées, permettant des habillages divers de timbres ou de poèmes et vice versa. Preuve en est donnée par la délicieuse Mme de Sabran, femme peintre et veuve, dont De Boufflers s'était épris, laquelle lui écrit le 21 mai 1778 : "nous faisons actuellement une romance sur le même sujet et sur le même air que le votre, qui n'aura pas tout à fait le même mérite, mais nous vous la donnerons à corriger. Je vous l'enverrai ces jours-ci, parce qu'il nous reste encore quelques couplets à faire".
Par "romance" Mme de Sabran entend une chanson comme une
autre, faite d'une poésie sentimentale et mélancolique, spécialement d'inspiration
amoureuse, une chanson tendre sans spéciale caractéristique de longueur
ou de genre, quoique généralement conçue dans une forme à couplets, et
mis à l'honneur vers 1780. La romance se développe sous la Révolution
et l'Empire. Son nom, d'origine espagnole, est porteur d'un concept évolutif,
car elle fut avant tout la chanson du XIXème siècle. Elle se distingue
de la chanson ordinaire parce qu'elle est destinée, écrit Duneton, "à
mettre en valeur la voix du chanteur ou de la chanteuse par le moyen d'une
mélodie aux complications "charmeuses"; la simple chanson de l'époque
- prenons celle des gens du Caveau - fonde son impact essentiellement
sur la pertinence des paroles, l'efficacité des vers… en tout cas sur
l'intérêt du récit, plutôt que sur le charme d'une ligne mélodique. La
musique de la romance, elle, comporte dès 1800 de brusques écarts de voix,
des passages subits dans l'aigu, souvent à l'octave, suivis de dégringolades
non moins brutales dans le grave, et tout cela exige une oreille exercée,
passablement travaillée…"
Les quelques timbres évoqués pour notre chanson 29 illustrent le propos de Duneton. L'air donné par Laborde comme d'origine gasconne dépasse l'ambitus de l'octave, mais celui qu'il fournit dans son même ouvrage pour De mon berger volage s'y tient tout juste, et sa variante du caveau (air n°134) dito. En d'autres termes l'air fourni par Laborde annonce mieux la romance dans un cas que dans l'autre.
Certes rien n'empêcherait le texte du recueil Berssous d'être supporté aussi par le timbre de "De mon berger volage", d'autant que les rimes en -age des vers 1 et 3 de chaque première strophe, parce qu'identiques, peuvent suggérer un échange parallèle d'air. Par ailleurs le récit de la première strophe consiste, dans les deux cas, à poser le principe d'une bergère éplorée. Enfin les deux chansons ont même mesure à trois temps.
Mais les contextes chronologiques des variantes Berssous et De Boufflers ne sont pas les mêmes. En cette période mouvementée, voire inquiétante de la Révolution, le Chevalier de Boufflers a-t-il voulu s'attribuer tout le mérite de cette chanson qu'il intitule les Regrets de Climène, en restant fidèle au poème vernaculaire, ou ne pas évoquer le musicologue l'ayant publiée une décennie plus tôt, d'autant qu'il fait d'abord porter son texte de 1790 par un timbre différent de celui de 1780 ?
C'est que Jean-Benjamin Laborde, né à Paris en 1734, renommé compositeur et musicologue, parce qu'il a été aussi le favori et le valet de chambre de Louis XV, puis gouverneur du Louvre, fermier général et financier dilettante(4), n'est pas en odeur de sainteté jacobine. Il mourra sur l'échafaud le 22 juillet 1794, cinq jours avant la chute de Robespierre. Mais cet élève de Rameau pour la composition a écrit de nombreuses chansons, des parodies pour le théâtre de la Foire, de nombreuses œuvres (tragédie lyrique, comédie, ballet, pastorale, opéra-comique) jouées à la cour et à l'Opéra de Paris. De son Essai sur la musique ancienne et moderne, très renseigné, est tiré notre chanson gasconne ou modèle d'origine.
L'autre personnage, le Chevalier de Boufflers, quoique d'une génération plus jeune que celle de Berssous ou Laborde, fréquenta même nos pays du Léman. Ce militaire de carrière se rendit en effet en 1765 à Ferney, reçut fort bon accueil de Voltaire qui l'avait vu tout enfant à la cour de Stanilas Leczinski, à Luneville, et parcourut la Suisse en se donnant pour un peintre au pastel qui se faisait appeler M. Charles(5). Grâce à ce talent, dont les tableaux ne sont pas connus, il ébaucha plus d'une aventure galante que Voltaire, dans sa correspondance quotidienne, et lui même, dans ses lettres en vers et en prose adressées à sa mère, se gardent bien de dissimuler. Il fut le meilleur chansonnier de la décennie 1780-1790.
Député de la noblesse aux Etats Généraux pour le bailliage de Nancy, Stanislas-Jean de Boufflers fut rapporteur à l'Assemblée Nationale de divers projets sur l'application des récompenses nationales aux inventeurs et découvreurs, tout en appartenant au Club des Impartiaux(6). Formée en 1789 ; cette société de monarchiens, de députés d'opinion modérée, anciens "patriotes" effrayés par la violence du mouvement révolutionnaire, disparut en 1790.
L'année, pour le député de Nancy, fut particulièrement mouvementée et alarmante sur la tournure des événements(7). Le 1er août les soldats des trois régiments formant la garnison de la capitale lorraine s'opposent à leurs officiers, dont un de ces gradés ayant fait punir une sentinelle, les subordonnés se révoltent. L'insurrection s'étend aux environs. La municipalité demande au maréchal de Noue, commandant des troupes, de faire des excuses publiques. Il est obligé de s'incliner, et pour les soldats, c'est là une victoire. Mais le 16 août l'Assemblée Nationale décide que ceux qui ont provoqué la révolte de Nancy seront châtiés par la peine capitale et ceux qui y ont participé absous sous condition de repentir. Afin de rétablir l'ordre le maréchal Malseigne, envoyé sur place, se montre si brutal que ses soldats finissent par l'emprisonner. On ordonne alors à Bouillé, depuis Toul, d'approcher de Nancy avec 5000 hommes. Il pénètre dans la ville, le combat dure deux heures. Bilan : 300 morts ou blessés. Une véritable terreur militaire va régner alors sur la capitale lorraine : quarante et un soldats sont condamnés aux galères. Or le 6 décembre, Sillery, un député jacobin, donc adversaire politique du Chevalier de Boufflers, nancéien, expose à l'Assemblée les véritables dessous de cette affaire et le bien fondé de la révolte de la troupe. Les condamnés par le tribunal de Bouillé seront libérés. Mais l'armée de métier à laquelle appartient De Boufflers se trouve de plus en plus divisée et les soldats de plus en plus éloignés des officiers. Cependant l'Assemblée n'ose pas prendre la mesure préconisée par Robespierre : licencier tous les officiers et les remplacer par les sous-officiers.
Ce climat incite De Boufflers à émigrer d'assez bonne heure semble-t-il. Donc, en 1793, quelque allusion à un fermier général et favori de Louis XV, même par le rappel du simple collecteur d'une chanson gasconne, pouvait rendre sans doute suspect tout repreneur donnant sa source. Manière de dire que Berssous, sous la Révolution, n'aurait pas eu non plus intérêt à recueillir un tel héritage culturel, aussi bien celui d'un emprisonné puis guillotiné, que celui d'un émigré : la présence de la chanson dans le recueil tend à l'y faire figurer bien avant cette période politique tendue, et avant l'an 1799 figuré en tête du recueil, quand la Savoie est déjà française.
(1) Dans Slatkine p. 559 et 575 (timbre n°3)
ou dans le recueil initial VII, p. 166 (air n°3).
(2) A. Lagarde et L. Michard, La littérature française, 2/ Des
classiques aux philosophes, Bordas-Laffont éd. 1971, p. 474-475.
(3) La Borde (J.-B. de), Essai sur la musique ancienne et moderne,
Paris, 1780, P.-D. Pierres imp., cote BNm, 4°Vm 231(2), 4 vol. Présentement
t. II, p. 150.
(4) Dictionnaire de la musique, par Marc Honegger, Bordas éd.,
Paris 1979, t. II, p. 602.
(5) Grande Encyclopédie, t.1, p. 625-626. Sur l'œuvre du Chevalier,
voir C. Duneton, t. II, op. cité, p. 71-80 notamment.
(6) Ibid.
(7) Le récit qui suit vient de : A. Castelot et A. Decaux, Histoire
de la France et des Français, Perrin et Larousse éd., 1980, Paris,
t. VI, p. 177-179.



