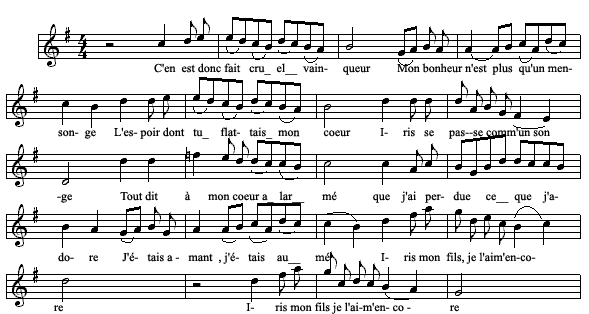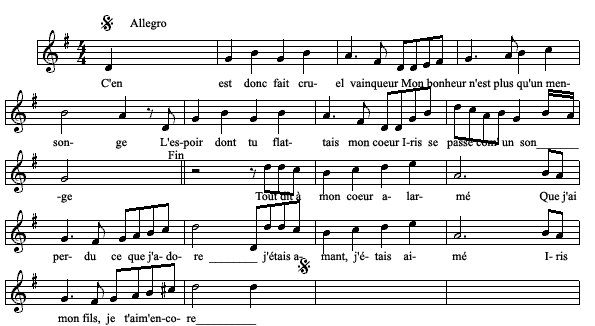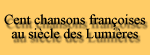
49
C'EN EST DONC FAIT CRUEL
(air non identifié)
C'EN EST DONC FAIT CRUEL
(air non identifié)
1
C'en est donc fait cruel vainqueur
Mon bonheur n'est plus qu'un mensonge.
L'espoir dont tu flattais mon cœur
Iris se passe comme un songe.
Tout dit à mon cœur alarmé
Que j'ai perdu ce que j'adore.
J'étais amant, j'étais aimé
Iris, mon fils, je l'aime encore.
2
Si je lui fais quelque chanson
Ou qu'il me parle de ma constance
Elle me rebute avec un ton
Avec un air d'indifférence.
Tout dit mon … bis*
3
Quand il est avec ces rivaux
En déclinant seul à l'ombrage
Les plus aimables de mes maux
Puis-je la trouver charmante ?
Tout dit à mon … bis*
4
Quand nous étions dans ce coteau
Nos brebis n'avions qu'un seul maître.
A présent dans ce champ nouveau
Où nous laissons courir nos bêtes
Tout dit à mon… bis*
5
Pleurez agneau, très doux agneau
Lubin a pris de moi la fuite.
Vous n'avez plus d'autre soutien
Que de mon chien et ma houlette.
Tout dit à mon cœur alarmé
Que j'ai perdu ce que j'adore.
J'étais amant, j'étais aimé
Iris, mon fils, je l'aime encore.
*NDLR : Le mot bis signifie que se répète
entièrement le refrain tel qu'il est, complet, en deuxième moitié des
première et cinquième strophes.
Les pages de cette chanson, répertoriée par cet incipit à la table des
matières, ont été arrachées du manuscrit à un moment indéterminé, puis
retrouvées dans la même maison abandonnée où le recueil a été découvert.
Elles constituent une seule feuille paginée recto verso 119 et 120, comme
pour les autres, par des numéros aux angles supérieurs. Mais une partie
absente et déchirée ne permet plus d'y lire la queue du 9 de 119.
Sans changer de refrain
Une chanson avec un refrain de longueur exceptionnelle puisque de quatre vers, autant que le couplet!
Les chansons à refrain sont plus anciennes que leur terme qualificatif, apparu vers 1260, et qui définit une suite de mots ou de phrases sur une ligne mélodique propre, qui revient aujourd'hui(1) à la fin de chaque couplet, à partir d'un poème à forme fixe : l'étymologie en est le participe de l'ancien français refraindre, "briser", du latin refrangere, mais l'existence de ce retour séquentiel est déjà associée aux plus anciennes formes lyriques (litanies sumériennes, psaumes litaniques, litanies égyptiennes, psalmodie chrétienne primitive, etc.… qui ont une formule immuable après chaque invocation). Dès le Xème - XIème siècle, les manuscrits montrent maints exemples de chants latins, religieux ou profanes, ayant refrains, et traités différemment parfois par la langue utilisée. Avec les troubadours et les trouvères ce leitmotiv, essentiel, apparaît comme un vers ou un groupe de vers, à la rigueur sous forme de quelques onomatopées ou sous la plus réduite d'une exclamation (eya !), tous chantés sur une mélodie invariable. Et dans les principales formes de chansons à refrain et de danse associée, à partir du XIIIème siècle la grande vogue du motif lui donne une existence nouvelle, autonome, avec ses paroles ou sa mélodie utilisées sur des textes divers. Certaines chansons, comme celle de la Belle Aelis, ne sont qu'assemblages de refrains divers. Genrich a répertorié près de 1300 refrains médiévaux dans les divers genres de pièces dansées ou/et chantées, avec un tiers du total de ces leitmotiv qui sont notés "sans qu'il en ait épuisé les sources"(2).

Le refrain occupera sous la Renaissance une place de choix dans le rondeau, lequel est avant tout une chanson de danse : de 2 vers au moins, de 8 au plus, posé en tête et repris deux fois, partiellement ou intégralement, une fois au milieu de la pièce, puis à la fin, le refrain s'inscrit dans la structure métrique par sa rupture qui découpe, conduit et traduit le genre.
Le "tra la la la" qui forme certains refrains, apparemment sans queue ni tête ou rapport visible avec les rares vers de certaines chansons, rend, pour chaque danseur, l'effort musculaire de tenir la cadence, ou l'accélérer, moins pénible, puisque l'individu n'a plus en même temps à mobiliser son attention sur un texte trop riche, surprenant et complexe. Cette facilité à retenir un refrain grâce à sa simplicité et répétitivité en a fait son succès.
La longueur du refrain, donc, est très variable : quoique souvent réduit au dernier vers d'un quatrain, il peut s'étendre cependant, comme dans la présente chanson, à la moitié d'une strophe de huit vers. Parfois il arrive qu'il y ait double refrain, la moitié des strophes étant dotées d'un type et l'autre moitié du second. Mais existent aussi des textes où seuls quelques couplets en sont équipés. Et, même systématique dans toutes les strophes, le refrain peut se modifier légèrement en libellé afin de suivre la progression ou la spécificité de la stance : on touche alors aux limites de son principe et de son utilité. Car le second avantage dudit leitmotiv, à rôle non exclusivement rythmique, et avec ses paroles, est que son texte, aussi, va bien aux structures de chansons où chaque strophe a une relative indépendance par rapport aux autres, en la ponctuant chaque fois comme par une même conclusion, un chute, une philosophie, un rappel thématique. Mais le refrain reste par contre rupture trop marquée lorsque l'ensemble du poème strophé raconte quelque histoire, rapporte un dialogue. Ce n'est pas le cas présent où chaque couplet reformule à peu près la même doléance, avec visiblement des erreurs de transcription, de grammaire, de pronoms personnels.
Faute de partition associée au manuscrit on peut proposer l'air On compterait les diamants (Clef du Caveau n°423), un vaudeville utilisé dans le dernier quart du XVIIIème siècle(3) pour porter des huitains de même coupe. L'ambitus un peu plus fort de la deuxième partie du timbre permet de lui faire jouer le rôle de refrain, d'autant qu'une séquence musicale supplémentaire, en l'occurrence inutile et à supprimer ici, pourrait faire répéter le dernier vers dudit refrain, si le bis du manuscrit s'y rapportait.
Clé du Caveau, n°423 :
Irait aussi bien le timbre du vaudeville de "J'ai des plumes du perroquet", "A tout le monde il serait doux", air numéroté 790 en la Clef du Caveau, et vaudeville dont Longchamps fut l'auteur. Telle qu'elle est donnée, la mélodie du refrain reste en suspens sur le ré alors que sa chute devrait se résoudre sur un sol. Mais le encore qui clôt le texte, c'est-à-dire un adverbe de temps, marquant la persistance d'un amour au moment considéré, peut s'accommoder thématiquement au mouvement chromatique ascendant si le mot par son second sens marque plutôt l'idée de répétition, de supplément en équivalence avec davantage. Sinon, légère adaptation ou correction sur deux mesures en finale est à faire.
Clé du Caveau n°790 :
(1) Au Moyen Age la place du refrain a pu
varier : on le trouve après la strophe, au cours de la strophe, avant
le premier couplet, et après les suivants (virelai), enfin dispersé entre
les vers du couplet (rondeau). Cf. : Gd. Larousse encyc.,
Paris 1964, t.9, p. 83, voir ci après.
(2) Gd. Larousse, ibid.
(3) Par exemple pour l'Invocation à l'hyver, sur un texte romantique
du chevalier de Piis en 1783, publiées dans les Etrennes lyriques de cette
années là, p. 135-137.