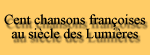
68
LA PRISE DE MILAN
LA PRISE DE MILAN
1
Noble Milanais
Voyons les Français
Qui viennent pour te saluer.
Retirez-vous Sire.
Retournez chez vous.
Nous sommes de l'Empire
Français, retirez-vous,
Il n'y a rien à faire chez nous.
2
Quoi dis-tu, Milan !
Tu parles bien hardiment.
Seras-tu si méchant ?
J'ai des fortes poudres,
Bons mortiers et canons
Qui te feront résoudre,
De bonne façon,
En changeant de résolution.
3
Faites vos efforts !
Français, Espagnols,
J'ai des fortes places,
Des bons soldats dedans.
Je prétends me battre
Jusqu'au dernier sang
A l'honneur de l'Empereur-le-Grand.
4
Tirez mes(1) canonniers,
Tirez mes bombardiers.
Faites feu sans relâcher,
Echauffez cette place,
Sans rémission,
Bombes et carcasses,
Mortiers et canons.
N'épargnez point la munition.
5
Milan a souffert
Comme vous un enfer
Quatorze jours sans relâcher.
Le dix-neuf de décembre
Milan s'est rendue ;
Sans pouvoir prétendre
Secours d'aucun lieu
A toujours été convaincue.
(1) Le possessif, non indispensable pour la compréhension, introduit une syllabe supplémentaire dans la métrique par rapport aux homologues des autres strophes.
Par l'octogénaire maréchal de Villars, les cocardes de 3 reines au chapeau… (1)
La strophe 3 de la chanson donne les grandes lignes du contexte
international : il est postérieur au traité de Londres (1718) ayant créé
le Royaume de Sardaigne pour la Maison de Savoie ;  le
Milanais va rester sous la tutelle autrichienne jusqu'en 1796, la guerre
de succession d'Autriche et le traité d'Utrecht ayant eu pour résultat
de substituer en Lombardie la domination germanique à la domination hispanique
dont le comte de Vaudémont y fut le dernier représentant du roi Philippe
V.
le
Milanais va rester sous la tutelle autrichienne jusqu'en 1796, la guerre
de succession d'Autriche et le traité d'Utrecht ayant eu pour résultat
de substituer en Lombardie la domination germanique à la domination hispanique
dont le comte de Vaudémont y fut le dernier représentant du roi Philippe
V.
Pendant la première période l'empereur d'Autriche, Charles VI, ne put éviter que Milan eut à subir les conséquences de la guerre de succession de Pologne, puisqu'il soutenait son neveu électeur de Saxe contre le roi Stanislas, beau-père de Louis XV. La France s'unit avec l'Espagne et la Sardaigne dont "le roi Charles Emmanuel espérait le Milanais, et il lui fut promis par les ministres de Versailles et de Madrid… Cette guerre d'Italie est la seule qui se soit terminée avec un succès solide pour les Français depuis Charlemagne. La raison en est qu'ils avaient pour eux le gardien des Alpes, devenu le plus puissant prince de ces contrées, qu'ils étaient secondés des meilleures troupes d'Espagne et que les armées furent toujours dans l'abondance…"(2).
Dès la fin de 1733, quarante mille Français entraient en campagne dans les Alpes sous le commandement du maréchal-général de Villars, doté d'un titre qui n'avait pas été porté depuis Turenne. L'octogénaire qu'il était fit à son départ un promesse superbe : "le roi peut disposer de l'Italie dit-il à Fleury, je vais la lui conquérir"(3).
Effectivement la jonction avec le Piémont, le passage du Tessin s'opérèrent sans difficulté. L'empereur d'Autriche avait négligé de mettre le Milanais en défense : ses troupes d'occupation, sous Daun, étaient en trop petit nombre pour tenir la campagne et durent s'enfermer dans des places. Comme le conclut la strophe cinq de la chanson, Milan s'est rendue du fait que
"Sans pouvoir prétendre
Secours d'aucun lieu
A toujours été convaincue.
Villars entra donc en triomphe dans la ville elle-même, portant à son chapeau trois cocardes que lui avaient donné trois reines, celles de France, d'Espagne, et de Sardaigne(4). Il lui fallait encore mener l'attaque de la citadelle proprement dite. Il fut convenu avec le général Visconti, gouverneur de la place, que l'on n'attaquerait pas la citadelle du côté de la ville et que par la même raison il ne ferait point tirer sur elle. Ce qui fut fait de part et d'autre mais plusieurs des boulets français, passant par dessus le château par un tir trop allongé, vinrent néanmoins tomber dans la cité, y provoquant les dommages, comme y fait allusion la même strophe.
Dans la nuit du 15 au 16 décembre la tranchée fut certes ouverte par les Français et les Sardes, mais les assiégés, bien dotés en artillerie comme l'assure la strophe quatre, continuèrent les jours et nuits suivants à faire grand feu de canons et de mousqueterie sur les assiégeants, y perdant de leurs effectifs.
 De
Villars voulut donner aux dames et à la noblesse de Milan un grand souper
suivi d'un bal que le maréchal ouvrit lui-même avec la princesse de Tivulle
: le premier coup de canon tiré par l'artillerie française, le 20 décembre
vers une heure du matin, fut le signal donné à l'orchestre pour l'ouverture
du bal. Le maréchal y dansa quatre menuets de la meilleure grâce du monde,
peu ordinaire à son âge si avancé. D'une gaieté circonstancielle et extrême,
le stratège en communication qu'il était aussi, déclara qu'il était beau
à lui de donner deux bals à la fois, l'un à la ville, l'autre à la citadelle.
Mais sous cette sérénité de façade le vieux guerrier s'efforçait de cacher
ses souffrances physiques et son inquiétude sur l'avenir de ses conquêtes.
De
Villars voulut donner aux dames et à la noblesse de Milan un grand souper
suivi d'un bal que le maréchal ouvrit lui-même avec la princesse de Tivulle
: le premier coup de canon tiré par l'artillerie française, le 20 décembre
vers une heure du matin, fut le signal donné à l'orchestre pour l'ouverture
du bal. Le maréchal y dansa quatre menuets de la meilleure grâce du monde,
peu ordinaire à son âge si avancé. D'une gaieté circonstancielle et extrême,
le stratège en communication qu'il était aussi, déclara qu'il était beau
à lui de donner deux bals à la fois, l'un à la ville, l'autre à la citadelle.
Mais sous cette sérénité de façade le vieux guerrier s'efforçait de cacher
ses souffrances physiques et son inquiétude sur l'avenir de ses conquêtes.
Le 21 au matin 33 pièces de canons et 12 mortiers tirèrent avec tant de violence que le feu des assiégés diminua. Le 23 ces derniers abandonnaient le chemin couvert. La capitulation fut signée à minuit, le 29, et le 30 les assiégés livrèrent aux alliés une des portes du château. La garnison obtint les honneurs militaires, laissant dans la place 56 bouches à feu, maints barils de poudre, des munitions et subsistances en quantité.
Ces précisions confirment les dires de la chanson sur la durée du siège, 14 jours, compte tenu de l'équipement en artillerie de la citadelle, comme le suggèrent les strophes 2, 3 et 4 de la chanson. Seule erreur, la forteresse s'est rendue le 29 et non le 19 décembre, sauf si l'auteur du texte a voulu évoquer la cité elle-même, déjà conquise et bien en main par le maréchal pour y organiser son bal dès le lendemain.
Mais sont justes aussi le ton et l'esprit du propos. Sauf pour une noblesse vite séduite par le train des fêtes qui reprend, les troupes françaises et sardes ne sont pas reçues en libératrices par la population, comme en témoigne la correspondance de M. de Fontanieu, qui en informe inquiet, par courrier du 13 décembre 1733, le ministre de la guerre français. "Retirez-vous" s'exclame la strophe 1 de la chanson, car le tortueux roi de Sicile, avec sa cour, est descendu en grande pompe à l'église du Dôme, en se sentant mal accueilli, ne serait-ce que pour les prélèvements qu'il opère mais qu'il dit dus à la pression française. Son puissant allié est accueilli avec le même refus : "Français retirez-vous, Il n'y a rien à faire chez nous".
Quand Berssous s'attribue le recueil, le fait d'armes est vieux de plusieurs décennies et cette chanson de circonstance plus que désuète. Son timbre porteur, par strophe de vers en 5, 5, 7-8, 6, 6, 6-7, 5, 8 syllabes méritait-il une telle conservation ?(5)
Les événements prédisposent d'ailleurs aux réminiscences militaires : en 1796 l'armée d'Italie, avec Bonaparte, remporte, d'abord sur le Piémont une série de victoires, puis sur les Autrichiens de nouvelles en 1797, lui permettant, maître de toute l'Italie du nord, d'envahir l'Autriche. Le traité de Campo-Formio, en octobre, entraîne, dans l'orbite française, la création de la République cisalpine (Milanais) et de la République ligure (Gênes).
Mais le collecteur du manuscrit Berssous se remémorerait-il seulement la précédente campagne d'Italie ? S'il avait 82 ans, comme peut le suggérer la chanson 93 et finale de son recueil sur le vieillard philosophe, il eut atteint environ la majorité en 1733 lorsque l'octogénaire duc de Villars prit Milan. Et comme "la valeur n'attend pas le nombre des années" c'est vers cet âge-là d'ailleurs que le futur maréchal était devenu soldat, puis colonel à 21 ans ! Le décalage de générations n'empêchait pas que le parallélisme de longues destinées frappe quelque vieux soldat retiré dans la vallée d'Abondance, surtout s'il avait pris part à cette bataille de Milan dont la chanson serait ainsi la première étape chronologique de la collecte, même tardivement notée.
Lors de cette même guerre de succession de Pologne, la ville de Philipsbourg dut se rendre aux Franco-piémontais. Un barde vaudois du Piémont écrivit une chanson, ci-après donnée, sur cette prise de cité qui évoque celle de Milan.
(1) Voltaire, Histoire de la guerre de
1741, éd. Garnier, Paris, 1971, p. 318-319.
(2) Lavisse et Rambaud, Histoire générale du IVème siècle à nos jours,
t. 7.
(3) A Casati, Milano e di principi di Savoia, Turin, 1859, p. 165,
peut être consulté pour le point de vue italien sur cette guerre.
(4) Nous suivons désormais le récit de C. Pajol, Les guerres de Louis
XV.
(5) On présage à quelque timbre semblable à celui de Brave capitaine,
bien étudié par Coirault (Formation de nos chansons folkloriques,
op. cité, p. 305 et s.), Tiersot ou Servettaz-Delarue, mais portant seulement
6 vers, plus courts et réguliers.

