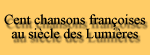
74
LE PRIX DE MON SILENCE, TON PUCELAGE
LE PRIX DE MON SILENCE, TON PUCELAGE
1
L'autre jour me prit envie
De m'en aller promener.
Sur mon chemin je fis rencontre
D'une aimable Louison
Qui se fondait tout en larmes
D'avoir perdu des moutons.
2
Qu'avez-vous jeune bergère ?
Qu'avez-vous à tant soupirer ?
Par malheur je me suis endormie,
Mes moutons sont égarés.
Qu'irai-je dire à ma mère ?
Je n'ose plus y retourner.
3
Ne crains rien belle bergère.
Ne crains rien pour le courroux.
Nous irons dire à ta chère mère
Qu'ils sont tous mangés du loup.
Donne moi ton pucelage
Je n'en dirai rien du tout.
4
Quoi, donner mon pucelage !
Après avoir perdu mes moutons
Je serai bien cent fois plus sage
De retourner à la maison.
Je garderai mon pucelage.
J'irai chercher mes moutons.
Le type même de l'ancienne pastourelle française… revue et corrigée !
 A
des détails de rédaction près, les quatre strophes de cette chanson du
manuscrit Berssous font partie des huit d'une seconde trouvée à Charmoille(1),
des cinq d'une troisième collectée à Courroux(2), là encore dans le Jura
suisse, par A. Rossat au début du XXème siècle, enfin des quatre de la
quatrième recueillie dans l'Ain par Guillon en 1883(3). Ces trois dernières
chansons ont été rapprochées de voisines d'esprit retrouvées en Gruyère,
à Fribourg et ailleurs dans le Jura par J. Urbain, dans son livre étoffé
sur La Pastourelle française(4).
A
des détails de rédaction près, les quatre strophes de cette chanson du
manuscrit Berssous font partie des huit d'une seconde trouvée à Charmoille(1),
des cinq d'une troisième collectée à Courroux(2), là encore dans le Jura
suisse, par A. Rossat au début du XXème siècle, enfin des quatre de la
quatrième recueillie dans l'Ain par Guillon en 1883(3). Ces trois dernières
chansons ont été rapprochées de voisines d'esprit retrouvées en Gruyère,
à Fribourg et ailleurs dans le Jura par J. Urbain, dans son livre étoffé
sur La Pastourelle française(4).
C'est par nature un dialogue dont J. Urbain note qu' "on y retrouve des éléments et des situations qui ont fait fortune dans un nombre impressionnant de pastourelles : la rencontre fortuite, le cœur en gage, les moutons mangés par les loups, l'humilité de la bergère et pour finir, le galant éconduit qui s'en va attendre l'heure du trépas dans la montagne"(5). Les ingrédients orographiques et du loup sont ici relativement bien appropriés au terroir savoyard et jurassien où ces chansons on été retrouvées.
J. Urbain ajoute : "le dialogue s'enchaîne généralement sur l'initiative du galant rencontrant une bergère fortuitement parfois, délibérément souvent…". Ce préambule est un procédé qui permet, grâce souvent à un stéréotype de salutation passe-partout, utilisé depuis le Moyen-Age, "au galant d'entrer en relation avec la bergère d'une manière apparemment naturelle. Car ce qui prime chez le galant, c'est de pouvoir se faire entendre de la bergère et obliger celle-ci à lui répondre. La suite du dialogue est toujours imprévisible, il se termine par le succès ou l'échec du galant, jamais sur une situation équivoque"(6).
 "Les
pastourelles dans lesquelles le loup intervient directement dans l'action
ou par allusion, sont nombreuses et extrêmement diversifiées sur le plan
du scénario"(7). Dans la présente chanson le prédateur n'intervient
par exemple que comme alibi. Mais ce thème de La bergère et le loup
montre une pastourelle rusée entraînant l'échec du galant, à partir
du moment où il demande ce qui n'avait pas été convenu préalablement avec
un comportement et des propos courtois, mais plus ou moins crus selon
les variantes. Vouloir ainsi le pucelage de la bergère dans la version
Berssous la différencie des autres moutures régionales. Cependant, à la
suite de Piguet, J. Urbain, soulignant la filiation solide des variantes
populaires de La bergère et le loup avec celle d'un manuscrit du
XVème siècle, publiée par Gaston Paris (comme l'a relevé Tiersot d'ailleurs),
remonte même jusqu'au XIIIème siècle : dans des chansons médiévales comportant
le même thème, la répertoriée II, 14 (d'après la terminologie de Faral(8))
montre le chevalier, secoureur et assommeur de loup, lésé dans sa récompense
du pucelage que la bergère rusée lui avait pourtant promis. Elle appelle
alors son amant Robin à son aide. C'est bien là l'esprit de la pastourelle
produite par les troubadours ou les trouvères aux XIIème et XIIIème siècles,
"dans laquelle un galant d'une classe élevée tente, avec ou sans succès,
de séduire une bergère"(9) . Mais au XVIIIème siècle, le genre mi-courtois,
mi-macho du séducteur aristocrate et imbu de lui-même, que l'original
médiéval présente de manière réaliste, devient celui, soit d'un notable
encore plus ridicule dans la chanson patoise savoyarde(10), soit d'un
simple dragueur dans la version du manuscrit Berssous. La lutte de classe
ostensible qui nous est illustrée par une bergère héroïne de la paysannerie,
femme rurale usant de la ruse et d'un franc langage, a disparu sous la
plume de citadins se voulant peuples dans un décor pastoral qui n'est
pas vraiment le leur, car ils ignorent ou veulent ignorer les inégalités
sociales qui demeureront, même après la Révolution d'une bourgeoisie à
laquelle ils peuvent appartenir.
"Les
pastourelles dans lesquelles le loup intervient directement dans l'action
ou par allusion, sont nombreuses et extrêmement diversifiées sur le plan
du scénario"(7). Dans la présente chanson le prédateur n'intervient
par exemple que comme alibi. Mais ce thème de La bergère et le loup
montre une pastourelle rusée entraînant l'échec du galant, à partir
du moment où il demande ce qui n'avait pas été convenu préalablement avec
un comportement et des propos courtois, mais plus ou moins crus selon
les variantes. Vouloir ainsi le pucelage de la bergère dans la version
Berssous la différencie des autres moutures régionales. Cependant, à la
suite de Piguet, J. Urbain, soulignant la filiation solide des variantes
populaires de La bergère et le loup avec celle d'un manuscrit du
XVème siècle, publiée par Gaston Paris (comme l'a relevé Tiersot d'ailleurs),
remonte même jusqu'au XIIIème siècle : dans des chansons médiévales comportant
le même thème, la répertoriée II, 14 (d'après la terminologie de Faral(8))
montre le chevalier, secoureur et assommeur de loup, lésé dans sa récompense
du pucelage que la bergère rusée lui avait pourtant promis. Elle appelle
alors son amant Robin à son aide. C'est bien là l'esprit de la pastourelle
produite par les troubadours ou les trouvères aux XIIème et XIIIème siècles,
"dans laquelle un galant d'une classe élevée tente, avec ou sans succès,
de séduire une bergère"(9) . Mais au XVIIIème siècle, le genre mi-courtois,
mi-macho du séducteur aristocrate et imbu de lui-même, que l'original
médiéval présente de manière réaliste, devient celui, soit d'un notable
encore plus ridicule dans la chanson patoise savoyarde(10), soit d'un
simple dragueur dans la version du manuscrit Berssous. La lutte de classe
ostensible qui nous est illustrée par une bergère héroïne de la paysannerie,
femme rurale usant de la ruse et d'un franc langage, a disparu sous la
plume de citadins se voulant peuples dans un décor pastoral qui n'est
pas vraiment le leur, car ils ignorent ou veulent ignorer les inégalités
sociales qui demeureront, même après la Révolution d'une bourgeoisie à
laquelle ils peuvent appartenir.
(1) Rossat : Manuscrit V, 353, Bibliothèque
Nationale Suisse, Berne.
(2) Rossat : Manuscrit V, 374, Bibliothèque Nationale Suisse, Berne.
(3) Chansons populaires de l'Ain, p. 341, Paris, 1883.
(4) J. Urbain, La Pastourelle française, en Suisse romande du Moyen-Age
à nos jours, éd. de la Thièle, Yverdon, 1986.
(5) Ibid., p. 152.
(6) Ibid., p. 144.
(7) Ibid., p. 351.
(8) Ed. Faral, La Pastourelle, Romania, t. XLIX, Paris, 1923.
(9) E. Piguet, Evolution de la Pastourelle du XIIème siècle à nos jours,
p. 9, Berne, 1927.
(10) Ouvrage collectif : Chansons savoyardes recueillies par E. Vuarnet,
Maisonneuve et Larose éd., Paris, 1997, p. 548 et s. : "Bonjour Sylvie".
Cl. Servettaz, Chants et chansons de la Savoie, Leroux et Abry
éd., Paris-Annecy, 1910, donne des variantes en français similaires :
La belle et le seigneur, La bergère et le fils du Roi, Charmante Elisabeau,
etc.


